
2 novembre 2021 par Jean Mermoz

2 novembre 2021 par Jean Mermoz
[ Peinture : María sur la plage de Biarritz, ou Contrejour -Joaquin Sorolla 1906 ]
 Nicolas Klein est agrégé d’espagnol, ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon et professeur d’espagnol en classe préparatoire. Il s’est spécialisé dans l’histoire, la culture et l’actualité du monde hispanique, tout particulièrement de l’Espagne. Il vient de faire paraitre Comprendre l’Espagne d’aujourd’hui – Manuel de Civilisation (éditions Ellipses) et il est l’auteur de Rupture de Ban – L’Espagne face à la crise (éditions Perspectives Libres)
Nicolas Klein est agrégé d’espagnol, ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon et professeur d’espagnol en classe préparatoire. Il s’est spécialisé dans l’histoire, la culture et l’actualité du monde hispanique, tout particulièrement de l’Espagne. Il vient de faire paraitre Comprendre l’Espagne d’aujourd’hui – Manuel de Civilisation (éditions Ellipses) et il est l’auteur de Rupture de Ban – L’Espagne face à la crise (éditions Perspectives Libres)
Cercle Jean Mermoz : Bonjour Nicolas Klein, nous sommes, comme nombre de français, très peu informés sur notre voisin espagnol. C’est peut être une manifestation de l’ironie historique, en ceci que l’Union toujours plus étroite des peuples européens devait rendre les lituaniens sensibles aux problèmes français, et les suedois en commisération devant la désolation grecque. On constate au contraire, un rétrécissement de la vue, un devenir-aveugle des pays européens à leur propre voisin. C’est pourquoi, vos analyses sur l’Espagne sont toujours très appréciées.
Notre rapport à l’Espagne est toujours semé d’incompréhension et de dédain – d’arrogance française, trop-française , subtilement reteinté en un désir latent d’exotisme. Pourtant, un grand patriote français comme Maurice Barrès, nous à chanté les louanges de ce pays, dans son somptueux “Greco où le secret de Tolède” qui vient d’être réédité dans la collection Bouquins. Pour nos camarades circonspect et tièdement conquis par la véritable singularité espagnole, voici ce que Barrès disait de la nation de Cervantès : “Tout se noie dans la lumière. Le paysage à l’infini déploie une couleur fauve, n’était un nuage vert sur un sol rougeâtre. Et voilà qui rend raison de la peinture espagnole. Cette terre écorchée émeut de la même manière qu’un Velasquez ou qu’un Greco ; même teinte et même superbe. Tout manifeste une volonté implacable d’être de la beauté” (Maurice Barrès – Romans et Voyages – Volume II , p.536). Justement, comment êtes-vous tombé dans la marmite espagnole ? Est-ce par la peinture et la beauté comme Barrès, ou votre chemin suit-il la fascination livresque de Don Quichotte ?
Nicolas Klein : Bonjour à vous et, avant toute chose, merci de m’interroger sur l’Espagne pour cet entretien. C’est toujours un plaisir pour moi de parler de cette passion.
Je risque de vous décevoir, néanmoins, pour cette première réponse car il m’est toujours très difficile de déterminer exactement ce qui a été le déclic de mon hispanophilie. Je crois que je suis venu à l’Espagne de plusieurs manières, la première étant la découverte de ce pays par ses régions, ses monuments, ses paysages (toutes choses que j’ai d’abord connues à distance, grâce à des atlas ou des recherches en ligne, avant de me rendre sur place pour la première fois en 2007).

[Alhambra de Grenade]
J’étais fasciné, je crois, par cette profusion de bâtiments dont certains étaient connus, certes (je pense, par exemple, à l’Alhambra de Grenade),mais dont beaucoup étaient (et sont toujours), pour le grand public français, des mystères dont le nom même n’était pas parvenu jusqu’aux grands médias. J’étais aussi étonné de voir, dans le secondaire, à quel point on ne me parlait quasiment jamais de l’Espagne, que ce soit en cours d’histoire ou de littérature. Notre voisin ibérique a donc commencé, à mes yeux, par être un champ d’exploration un peu « inédit ».
La littérature espagnole est venue plus tard, dès mes études en classe préparatoire littéraire, mais plus puissant encore a été l’attrait de l’actualité espagnole. C’était, une fois encore, une nation dont on parlait finalement assez peu, dont le monde politique était (et reste, je me répète) mal connu ; dont l’économie est souvent caricaturée ; dont la société, avec ses particularités, se noie bien vite, vue de France, dans une série de clichés sur les « pays latins » ou « méditerranéens » ; dont les dynamiques sont, en de trop nombreuses occasions, bien mal expliquées, quand elles ne sont tout simplement pas tues.
Je me suis aussi passionné pour les relations franco-espagnoles, notamment à certaines époques (depuis 1975, bien entendu, mais aussi au début du XXe siècle, par exemple, ou à l’époque moderne, pour remonter plus loin). Là encore, j’ai été interpellé par l’absence de grandes études globales sur la question du côté français – bien que certains ouvrages sauvent l’honneur en se concentrant sur des époques précises. À titre d’exemple, la France, dans sa construction en tant qu’État-nation moderne, doit énormément aux conceptions politiques et institutionnelles espagnoles mais ce phénomène a été superbement ignoré de ce côté-ci des Pyrénées jusqu’aux travaux de Jean-Frédéric Schaub.
Il est souvent difficile de faire comprendre aux Français que l’Espagne n’est pas une « France en plus petit » et que l’aborder sous ce prisme, même de bonne foi ou inconsciemment, ne peut nous attirer que des désagréments.
De façon générale, l’apport de l’Espagne à l’histoire occidentale et universelle, sa contribution aux lettres, aux arts et aux sciences, tout cela est encore trop méconnu en France (et dans d’autres pays). C’est aussi ce défi qui me passionne, je crois : je suis « tombé dans la marmite espagnole », pour reprendre votre expression amusante, parce que je voulais la faire mieux connaître à nos contemporains.
CJM : Votre réflexion sur le fait que nous considérions souvent l’Espagne comme une réduction de la France (une France à taille humaine pour les plus idolâtres-ignorants) est très intéressante. D’ailleurs, cette sainte ignorance n’épargne pas nos voisins italiens, eux aussi subissent le joug de cette ignorance mal dégrossie. Le fameux Arc-Latin, ou grande-latinité des pays du sud de l’Europe, est pour le moins une expectative enchanteresse, aussi bien sur le plan littéraire et philosophique, que politique et géostratégique. Néanmoins, notre impéritie intellectuelle doublée d’une idiote suffisance vis-à-vis de nos plus proches voisins latins, lanterne lourdement cette ambition.
Si nous fléchissons le regard sur notre Nation France, on peut sans mal affirmer que celle-ci est traumatisée par les deux guerres mondiales du siècle précédent, et que son rapport à sa propre histoire, est pour le moins ambigu. Alternant sans cesse entre le chant morbide d’une triste autoflagellation, et le sombre désir d’une pure annihilation de son passé, nous autres Français sommes ballotés dans les flots du déracinement. En miroir de cette désolation, notre voisin ibérique est-il lui aussi pris dans les rets de ce mal être historique ? Le poids de l’Histoire, récente ou antique, surnage-t-il l’ensemble de la société, ou au contraire, est-il totalement absent et réservé à une caste de mandarins universitaires ?
Nicolas Klein : C’est une excellente question car je suis intimement convaincu que l’Espagne et les Espagnols sont hantés par leur passé, qu’il soit proche ou lointain.
Au-delà, les disputes en direct ou par média interposé concernant le passé de l’Espagne sont monnaie courante outre-Pyrénées. C’est le rôle global de notre voisin pyrénéen depuis le Moyen Âge (Reconquête puis expulsion des Juifs et musulmans de péninsule Ibérique, par exemple) qui est discuté, gauche et droite s’écharpant parfois violemment. Les récents déboulonnements de statues honorant Christophe Colomb, des missionnaires ou des conquistadors espagnols en Amérique (aussi bien au nord qu’au sud) ont relancé des discussions sans fin sur la colonisation du continent et l’exploration de terres inconnues des Européens à l’époque moderne.
Dans ce cadre, plus vous vous situez à gauche de l’échiquier politique espagnol, plus vous maudissez le passé national, qui ne serait fait que de crimes, d’actes barbares et sanguinaires, d’ignorance, de fanatisme et d’imbécillité. Au contraire, plus vous penchez à droite, plus vous révérez cette histoire que vous voyez comme une série d’exploits ainsi que de découvertes et de batailles épiques.
Ajoutez à tout cela la désastreuse image historique de l’Espagne dans le reste du monde, en particulier en Europe (la célèbre « légende noire ») et vous obtiendrez une fierté nationale très faible. Cela est d’autant plus patent que ladite fierté est constamment remise en question par des séparatismes périphériques (Catalogne et Pays basque, principalement) agressifs et peu scrupuleux avec les faits présents ou passés. La plupart des Occidentaux voient en effet dans l’histoire espagnole un ramassis d’archaïsme, de violence aveugle, de catholicisme intransigeant, de bêtise et de déclin permanent – à se demander si ce pays a jamais été une puissance dans l’histoire, ce que certains, manifestement peu objectifs, finissent par affirmer. Beaucoup d’Espagnols ont fini par croire à ce récit, repris en chœur par un certain nombre de citoyens des nations américaines et de sécessionnistes basques et catalans.
L’histoire est donc une réelle passion espagnole, dans tous les sens du terme « passion » (un sujet majeur de leur vie collective et une souffrance tout aussi collective), à n’en pas douter.
CJM : Vos propos résonnent étrangement avec un autre hispanophile, moins connu mais très incisif dans ses affirmations : Emil Cioran. En effet, en 1966, l’aphoristicien de génie passa ses vacances estivales dans une petite ville catalanne, Talamanca, desquelles il composera le célèbre Cahier de Talamanca. Mais au-delà de ce livre, l’Espagne parcourt l’ensemble de son œuvre. Pour Cioran, l’Espagne est une formidable catharsis de la violence chrétienne — Conquistadors et Mystiques, poignard et crucifix, en symbiose dans un même peuple. Dans La tentation d’exister, publié en 1986, il revient plus longuement sur l’Espagne, en voici quelques extraits :« La décadence est en Espagne, un concept courant, national, un cliché, une devise officielle. La nation qui, au XVIè siècle, offrait au monde un spectacle de magnificence et de folie, la voilà réduite à codifier son engourdissement »(p.52) – « C’est le mérite de l’Espagne de proposer un type de développement insolite, un destin génial et inachevé. (On dirait un Rimbaud incarné dans une collectivité) » (p.54) Justement, ce sentiment de décadence et de déchéance est-il présent dans la société espagnole, ou n’est-il que le privilège de quelques esthètes catholiques, en mal de rétropédalage historique ?
Nicolas Klein : L’idée de déclin revient à intervalle régulier dans la conscience collective espagnole, souvent à la suite de moments d’expansion ou d’euphorie. Au XXIe siècle, après une période « vaches grasses » (nourrie en partie par la bulle immobilière des années 1998-2007), la crise économique mondiale de 2008 a entraîné une période de « vaches maigres » (forte augmentation du taux de chômage et de la précarité, insatisfaction générale face à son sort et à la marche du pays) dont le pays n’est jamais complètement sorti. La récession provoquée par la pandémie de coronavirus de 2020 a fortement réduit des activités essentielles à l’Espagne (tourisme, transports, commerce, consommation intérieure) et a détruit les espoirs nés de la reprise entamée dès 2014. Il faut ajouter à cela le sentiment, partagé par beaucoup de citoyens, d’une dégradation de la vie politique et de la moralité des institutions – ainsi que les craintes et les blessures nées du processus séparatiste catalan.
![[ Joaquin Costa (1846-1911) ]](https://www.cercle-jean-mermoz.fr/wp-content/uploads/2021/11/joachim-228x300.jpg)
[ Joaquin Costa (1846-1911) ]
CJM : L’Espagne semble prise dans les mêmes étaux politiques étriqués que la France du point de vue politicien. Nous autres français, vivons sous la terreur des « Bien-pensants » ( terme d’un autre hispanophile, le Grand d’Espagne Bernanos ); ceux-ci ont pour mission d’empêcher toute forme de contestation des idoles sacrées de notre époque. D’ailleurs, à la lumière des Gilets Jaunes, on à vu ressurgir un étonnant sentiment de haine de classe. La bourgeoisie française semble avoir trouvé, non pas sa valeur mais son faire-valoir – On se pose en s’opposant. La situation espagnole est-elle similaire du point de vue social ? Au sens où les classes sociales, que l’on prenait pour des catégories surannées à l’heure de la mondialisation heureuse, resurgissent-elles dans l’espace politique espagnol ?
Nicolas Klein : Je suis fermement convaincu de la validité du concept de classes sociales et il s’applique donc à l’Espagne. Les manifestations des « indignés », qui ont débuté le 15 mai 2011, ont remis au centre du débat les dégâts causés par la « mondialisation heureuse » dont vous parlez. Pourtant, à mon sens, une mauvaise lecture en a été faite par la suite. Il faut notamment incriminer Podemos (devenu Unidas Podemos lorsqu’il a absorbé une constellation d’autres partis de gauche « radicale »), qui s’est appuyé sur la colère légitime du mouvement du 15 mai pour le détourner au profit d’idées tout à fait contestables.
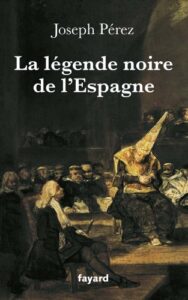 À cet égard, je ne saurais trop recommander à vos lecteurs un ouvrage tout à fait majeur en français,
À cet égard, je ne saurais trop recommander à vos lecteurs un ouvrage tout à fait majeur en français,
[ Propos recueillis par Camarade Henri ]