
21 mars 2022 par Jean Mermoz

21 mars 2022 par Jean Mermoz
[Photographie : Flickr Juan Asensio]
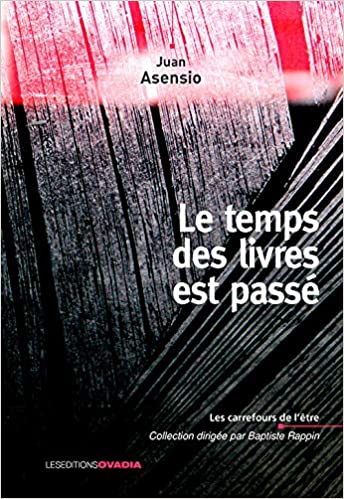 Juan Asensio, essayiste et critique littéraire, a créé le blog Stalker-Dissection du cadavre de la littérature au mois de mars 2004. Il est l’auteur de plusieurs contributions, préfaces (pour des textes d’Arthur Machen, Abel Bonnard, Michel Bernanos, George R. Stewart, etc.) et ouvrages, dont le dernier, Le temps des livres est passé, a paru aux éditions Ovadia.
Juan Asensio, essayiste et critique littéraire, a créé le blog Stalker-Dissection du cadavre de la littérature au mois de mars 2004. Il est l’auteur de plusieurs contributions, préfaces (pour des textes d’Arthur Machen, Abel Bonnard, Michel Bernanos, George R. Stewart, etc.) et ouvrages, dont le dernier, Le temps des livres est passé, a paru aux éditions Ovadia.
Initialement intitulé Orpaillages, Le temps des livres est passé est un recueil des différentes études qui ont lentement sédimenté le météore Stalker, votre blog littéraire où vous ambitionnez de « disséquer le cadavre de la littérature ». Tiré d’une lettre de Léon Bloy à Ernest Hello, le titre de votre livre est explicite quant à son constat sur l’absolue inanité de la littérature française contemporaine. Devenu un cloître égotique où les écrivains ne « cessent de se contempler dans le miroir pitoyablement ridicule que leur tendent quelques polichinelles faits femmes, hommes, lecteurs de si basse extraction » (p. 83), la critique littéraire, et donc par extension, la littérature française contemporaine, ne cessent de véhiculer ce que Michel Waldberg nommait violemment la « parole putanisée ». À rebours de cette exploration du néant, votre livre se compose exclusivement de louanges littéraires : la parole laudative, celle qui rehausse les grandes œuvres à leur sainte et juste place, y est prédominante. Bâti sur le modèle d’un pentagramme imaginaire qui serait sculpté dans une altière et roide roche, ce livre cathédrale se compose de quatre chapitres : La parole viciée, Monstres, Cratères et Célébrations. On remarque que les titres, en se suivant, peuvent s’enrouler circulairement autour d’un même axe possiblement rédempteur : les Célébrations deviennent ainsi des remèdes à la parole viciée — tout du moins, c’est ainsi que nous nous plaisons à l’imaginer. En explorant les harmoniques innombrables au sein de cette fresque qu’est le Temps des livres est passé, on entrevoit quelques récurrences. Métaphoriquement, et pour résumer sommairement : le motif du tapis anglais de James et celui, toscan, de Cristina Campo. Vos écrits se répondent et correspondent les uns avec les autres sous forme d’échos, de répercussions voilées et de résonances enfouies. Pour chaque œuvre, en recherchant les similitudes et les convergences qu’elle entretient avec d’autres textes de votre répertoire, vous recréez ce « tapis d’une merveilleuse complexité, dont le tisserand ne montrerait que l’envers noueux et confus » que Cristina Campo évoquait dans La flûte et le tapis. Loin de se scléroser en un calcaire froid, les grands textes littéraires se font ainsi jaspe, lazulite ou diamant : leurs éclats diffractent et réverbèrent le même scintillement sacré dont il convient d’examiner les reflets cachés.
 (Source : Flickr Juan Asensio)
(Source : Flickr Juan Asensio)
 Cercle Jean Mermoz : Soyons facétieux et inversons la narration originelle du récit d’Henry James pour découvrir l’envers noueux du tapis. Quelle serait, non pas pour la littérature, comme dans la nouvelle de James, mais pour votre critique littéraire, cette sève souterraine, cette scansion secrète qui « gouverne chaque phrase, [qui] choisit chaque mot, [qui] met un point sur chaque i, [qui] place chaque virgule » ? Pour retisser l’allégorie du tapis de Cristina Campo dans Les Impardonnables, quelle est « cette voix ardente de la flûte [qui] rythmait votre travail » ?
Cercle Jean Mermoz : Soyons facétieux et inversons la narration originelle du récit d’Henry James pour découvrir l’envers noueux du tapis. Quelle serait, non pas pour la littérature, comme dans la nouvelle de James, mais pour votre critique littéraire, cette sève souterraine, cette scansion secrète qui « gouverne chaque phrase, [qui] choisit chaque mot, [qui] met un point sur chaque i, [qui] place chaque virgule » ? Pour retisser l’allégorie du tapis de Cristina Campo dans Les Impardonnables, quelle est « cette voix ardente de la flûte [qui] rythmait votre travail » ?
Juan Asensio : Je ne sais pas grand-chose des caractéristiques de cette voix, et je ne sais même pas, à vrai dire, si elle fut constamment bruissante et même : exigeante dans mes oreilles, durant le nombre tout de même conséquent d’années durant lesquelles j’ai d’abord écrit ces différentes notes, ensuite les ai rassemblées et, corvée exténuante, supérieurement ingrate, ai tenté de les faire connaître à pas mal d’éditeurs ayant pignon sur rue comme on dit, qui tous me refusèrent ce manuscrit pour d’excellentes raisons que je résumerais plaisamment de la façon suivante : « Merci, cher Monsieur, de nous avoir adressé ce si gros – bien trop gros ! – manuscrit mais en fait, sachez que nous nous en contrefoutons, la critique littéraire n’intéressant plus personne, si tant est que la littérature intéresse encore quelqu’un, hormis peut-être les lecteurs de Leïla Slimani, Cécile Coulon, Yann Moix et Mathias Enard, que nous nous efforçons de servir selon nos moyens qui de jour en jour se réduisent à peau de chagrin ». Quoi qu’il en soit, je me suis obstiné, illustrant ce propos de Rachel Bespaloff évoquant Chestov et Nietzsche, selon lequel le rôle du philosophe – en l’occurrence, pour moi, le critique – consistait uniquement à préparer l’attente de la révélation – je cite ces propos de mémoire, extraits de Cheminements et carrefours.Je me tiens à une borne marquant la fin de ce qu’Elias Canetti nommait très bellement le territoire de l’homme, scrutant l’horizon à vrai dire de plus en plus sombre et, selon le commandement de Sainte-Beuve, j’exécute, du mieux que je le puis, l’office de vigie, rien de plus, rien de moins même si, pour être tout à fait exact, ce n’est pas tant les lointains que je fixe que ce qui se trouve derrière moi, et dont je tente de conserver quelques vestiges pour la nouvelle génération, autrement dit : vous.
Cercle Jean Mermoz : Voyez-vous un lien entre cette désaffection dont la critique se fait la proie et l’affadissement, voire la 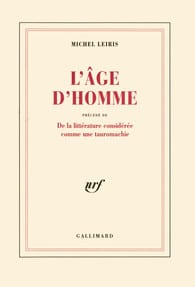 disparition de toute véritable littérature française contemporaine ?
disparition de toute véritable littérature française contemporaine ?
Juan Asensio : C’est une évidence car, sans jugement critique, sans possibilité d’un couperet, tout est permis, même les livres de Raphaël Enthoven, même ceux d’Annie Ernaux. Fut un temps point si éloigné de nous où les grands écrivains avaient intériorisé, en somme, cette exigence d’un regard extérieur jugeant leurs livres, par le biais de ce que Michel Leiris a appelé d’un beau nom évoquant un péril immédiat pour toute personne un tant soit peu virile et point alimentée de naissance au jus de racine de pissenlit bio, la « corne de taureau » : il fallait s’imaginer écrire avec, à l’esprit, la présence d’un danger fulgurant bien capable de vous encorner au moindre faux-pas, à la plus petite seconde d’inattention et même de baisse de tension, au moindre relâchement des nerfs et des gestes parfaitement maîtrisés. Désormais, ce danger non seulement n’existe plus mais n’est même pas imaginé et, si nous le supposions à l’œuvre, il serait immédiatement frappé d’infamie, voué aux gémonies progressistes de l’ouverture d’esprit si chère au ravi de la crèche Augustin Trapenard ; j’écris comme je me vide, voilà ce que ce dit l’écrinain contemporain, sans même se soucier du fait que, naguère encore, on tentait au moins de se cacher des regards en cas de déveine intestinale. Lorsqu’on interroge ce sommet arriviste de vulgarité qu’est Cécile Coulon en lui demandant quelle est sa première pensée, au réveil, elle répond fort tranquillement – pourquoi se gênerait-elle, du reste ? – qu’elle songe tout simplement à aller pisser. Si un livre, c’est quelqu’un, pour reprendre le bon mot de Victor Hugo, il ne faut pas s’étonner que le critique, au cas, du reste improbable, où il en demeurerait ailleurs que dans les salles de rédaction du Figaro (dit) littéraire ou du Monde des livres, payés à ne pas lire des livres qu’ils reçoivent en service de presse, ne se trouve plus du tout confronté qu’à des ombres d’ombres, des masques posés sur des masques dans une régression infinie comme le montre Bonaventura dans ses Veilles, mais des personnes – des quoi ? –, jamais.
Cercle Jean Mermoz : Dans À propos du roman, Paul Gadenne écrit qu’« un roman ne se résume pas, c’est pourquoi il est monstrueux ». Cette phrase résonne comme une écholalie avec l’épigraphe que vous donnez à la catégorie Monstres romanesques sur Stalker : « Le roman est un labyrinthe qui emprisonne le monstre du romanesque » (José Bergamín). Cette monstruosité indomptable du genre romanesque est peu souvent mise en valeur, tant le roman a été dévalorisé au rang de la simple historiette égostiste. Pourtant, d’immenses écrivains, comme Ernesto Sábato, ont quêté explicitement cette espèce rare, notamment dans L’Ange des ténèbres, le dernier volume de sa trilogie romanesque, où il revendiquait « le droit de faire des romans monstrueux ». Pour user d’une métaphore animalière comme Michel Leiris que vous citiez, votre mission critique n’a-t-elle pas quelque analogie avec le domptage, tant certains 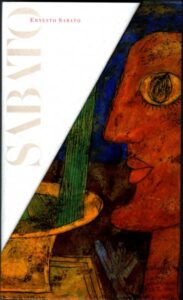 des romans que vous recensez semblent, pour le coup, indomptables, ou, tout du moins, paraissent pénétrés par un abyssal hermétisme ; (La Connaissance de la douleur de Gadda, Sous le volcan de Lowry, Monsieur Ouine de Bernanos, Absalon Absalon ! de Faulkner ou encore Nostromo de Conrad, pour ne citer que quelques exemples).
des romans que vous recensez semblent, pour le coup, indomptables, ou, tout du moins, paraissent pénétrés par un abyssal hermétisme ; (La Connaissance de la douleur de Gadda, Sous le volcan de Lowry, Monsieur Ouine de Bernanos, Absalon Absalon ! de Faulkner ou encore Nostromo de Conrad, pour ne citer que quelques exemples).
Juan Asensio : Je ne dompte aucune de ces grandes œuvres, d’autres encore – je songe ainsi à 2666 –, que vous citez, pour l’excellente raison qu’elles sont indomptables et que je ne me propose pas, devant les yeux ébahis des familles accompagnées de leurs rejetons enthousiastes à l’idée de sortir un dimanche après-midi au zoo ou au cirque, de faire un tour de piste à ces monstres ! Je désigne leur repaire, je le montre du doigt à ceux qui m’accompagnent et que je guide dans la Zone : le centre du labyrinthe, puis je m’y aventure, n’obligeant personne à me suivre,, pas même ces quelques courageux fatigués d’être pris pour des imbéciles et tournant en rond dans ce qu’Armand Robin appelait, dans sa Fausse parole, un « camp de concentration verbal », comme s’est aventuré au royaume souterrain des Aveugles Fernando Vidal Olmos, un des personnages les plus marquants et, surtout, troubles, du grand Ernesto Sábato. En fait, ce n’est pas pour rien qu’au moment de créer mon blog, en 2004 dans une salle des marchés, s’est immédiatement imposé le titre du chef-d’œuvre de Tarkovski, adapté d’un roman des frères Strougatski, évoquant des personnages qui s’aventurent à leurs risques et périls dans une Zone dont l’origine est sujette à toutes les hypothèses, précédés d’un stalker qui, lui, s’empêche de pénétrer dans la Chambre des miracles, par manque de foi, par respect, par une peur secrète aussi, sans doute, de ne pas résister à la tentation suprême de la toute-puissance. Je m’enfonce dans les profondeurs puantes, et j’en remonte les bras chargés d’étranges trouvailles et créatures, certaines point exactement agréables à regarder. Je les place sous les regards révulsés des demi-mondaines traînant au Café de Flore, et sous la truffe des caniches permanentés qui les accompagnent : tenez, voici ce que vous avez tellement oublié que vous avez presque réussi à nous les faire croire disparus, voici des livres, de vrais livres.
Cercle Jean Mermoz : Toujours à propos de ces Monstres romanesques, vous écrivez dans une note intitulée T. S. Eliott lecteur de Cœur des ténèbres où l’expérience du gouffre, qu’ils « fonctionnent comme des trous noirs », ces œuvres étant « elles-mêmes peut-être, à leur minuscule échelle », de « singularités littéraires qui paraissent aspirer le langage et dévorer ce qui les entoure. Les contempler, c’est comprendre que leur puits est sans fond » (p. 132 du Temps des livres est passé). Dans la même note, vous usez  longuement du vocabulaire de l’astrophysique pour illustrer votre propos (« censure cosmologique », « horizon des événements », « matière exotique », etc.). Ce rapprochement est pour le moins peu fréquent dans les ouvrages de critique littéraire. Quelle souterraine filiation unifie pour vous les espaces infinis et l’abime des immenses romans ?
longuement du vocabulaire de l’astrophysique pour illustrer votre propos (« censure cosmologique », « horizon des événements », « matière exotique », etc.). Ce rapprochement est pour le moins peu fréquent dans les ouvrages de critique littéraire. Quelle souterraine filiation unifie pour vous les espaces infinis et l’abime des immenses romans ?
Juan Asensio : J’ai développé ce rapprochement assez original en effet dans plusieurs textes, dont celui que vous citez, mais aussi dans un petit livre, Maudit soit Andreas Werckmeister !, épuisé je le crains. Il n’y a évidemment, dans ledit rapprochement, aucune prétention scientifique de ma part, puisque je me borne à observer que ce que l’on sait du fonctionnement, pour le moins exotique en effet, de ce que les astrophysiciens appellent improprement « trou noir » (par calque de l’anglais « black hole »), auquel je préfère l’ancienne appellation, bien plus poétique et finalement inquiétante, d’« astre occlus »,peut se révéler une métaphore utile si nous l’appliquons au fonctionnement (pour ainsi dire bien sûr) d’un certain nombre de grands textes romanesques qui « avalent » la matière qui les entoure ; nous savons que celle-ci ne disparaît jamais totalement et qu’elle est, d’une façon ou d’une autre, expulsée sous forme d’information. Je vois ainsi dans la fin de Monsieur Ouine de Georges Bernanos un exemple frappant d’un « disque d’accrétion » littéraire dans lequel s’engouffre la parole de l’ancien professeur de langues mais, tout autant, celle du romancier qui a bien failli être lui-même attiré par la colossale force de l’ogre, comme le montrent d’ailleurs les étonnants Cahiers de Monsieur Ouine, le grand écrivain luttant contre des 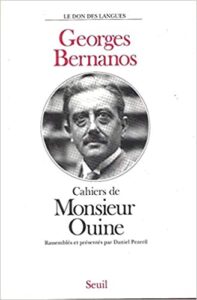 forces de marée qui semblent disloquer le langage. Si j’osais, j’affirmerais même que le dernier roman de Bernanos montre la liquéfaction de l’Occident tout entier devenu « paroisse morte » (qui fut, je le rappelle, le premier titre du roman). Nous pourrions évoquer d’autres œuvres, toutes exceptionnelles (mais, après tout, les trous noirs n’apparaissent eux-mêmes que dans certaines conditions, en guise de cerise cosmologique sur le gâteau pour ainsi dire, et fin apocalyptique d’astres prodigieusement massifs), comme par exemple Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, œuvres singulières, paradigmatiques, dans lesquelles se manifestent ces mêmes phénomènes de puissante houle gravitationnelle, de gloutonnerie démoniaque mais aussi (c’est là le point essentiel !) d’expulsion d’une matière transformée, cette l’information qui jamais ne se perd en somme, et constitue comme une sorte de sonde remontant de profondeurs inimaginables : Marlow remonte jusqu’à Kurtz, est tout près de tomber dans le puits de noirceur où l’aventurier, présenté comme le parangon de l’Europe des Lumières, a sombré, puis revient, redescend, à la civilisation, profondément transformé par son expérience. Voyez encore l’exemple de telle somptueuse nouvelle de Poe, dont la narration présente en somme, avec une surprenante économie de moyens narratifs, une impossibilité herméneutique, une aberration paradoxale d’un point de vue strictement conceptuel puisque l’écrivain imagine un texte ayant survécu à une chute dans le maelström. La voici, la véritable littérature : non pas une descente dans les profondeurs où Dante, accompagné de Virgile, est allé mais, infiniment plus difficile, une remontée à la surface, une anabase douloureuse mais supérieurement enrichissante.
forces de marée qui semblent disloquer le langage. Si j’osais, j’affirmerais même que le dernier roman de Bernanos montre la liquéfaction de l’Occident tout entier devenu « paroisse morte » (qui fut, je le rappelle, le premier titre du roman). Nous pourrions évoquer d’autres œuvres, toutes exceptionnelles (mais, après tout, les trous noirs n’apparaissent eux-mêmes que dans certaines conditions, en guise de cerise cosmologique sur le gâteau pour ainsi dire, et fin apocalyptique d’astres prodigieusement massifs), comme par exemple Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, œuvres singulières, paradigmatiques, dans lesquelles se manifestent ces mêmes phénomènes de puissante houle gravitationnelle, de gloutonnerie démoniaque mais aussi (c’est là le point essentiel !) d’expulsion d’une matière transformée, cette l’information qui jamais ne se perd en somme, et constitue comme une sorte de sonde remontant de profondeurs inimaginables : Marlow remonte jusqu’à Kurtz, est tout près de tomber dans le puits de noirceur où l’aventurier, présenté comme le parangon de l’Europe des Lumières, a sombré, puis revient, redescend, à la civilisation, profondément transformé par son expérience. Voyez encore l’exemple de telle somptueuse nouvelle de Poe, dont la narration présente en somme, avec une surprenante économie de moyens narratifs, une impossibilité herméneutique, une aberration paradoxale d’un point de vue strictement conceptuel puisque l’écrivain imagine un texte ayant survécu à une chute dans le maelström. La voici, la véritable littérature : non pas une descente dans les profondeurs où Dante, accompagné de Virgile, est allé mais, infiniment plus difficile, une remontée à la surface, une anabase douloureuse mais supérieurement enrichissante.
Cercle Jean Mermoz : Dans l’épigraphe de votre article Tristesse et joie de la parole (p. 47 du Temps des livres est passé), vous citez Ralph Waldo Emerson qui dans son livre La nature écrit que « la corruption de l’homme est suivie par la corruption du langage. » N’est-ce pas là une sentence qui condenserait votre si haute conception de la littérature et du langage ?
Juan Asensio : Oui, et je me demande surtout si ce n’est pas bien davantage la corruption du langage qui ne peut qu’entraîner, de façon inéluctable, la corruption de l’homme, cette concaténation, finalement beaucoup plus logique que l’autre, pouvant être considérée comme l’unique matière véritable, profonde, de la guerre qu’un Karl Kraus mena contre la Presse, comme le but poursuivi illusoirement – la recherche d’un langage qui n’ait pas besoin d’être soutenu, persuadé, qui ne trahisse pas la réelle présence et s’en fasse même la promesse puis la diligente servante – par le génial Carlo Michelstaedter dans La persuasion et la rhétorique. C’est en perdant l’usage d’une parole non pas, bien sûr, prétendument pure, quelque impossible idiome édénique antérieur à la dramatique séparation entre les mots et les choses, mais, à tout le moins, consciente de sa puissance, de sa verte primitivité selon Kierkegaard et pouvant être façonnée par les grands écrivains, c’est donc non seulement en perdant cet usage mais bien davantage tout désir de posséder, dans l’appréhension du monde, un langage aussi riche que possible et non point quotidiennement défiguré, que l’homme perd son rang d’homme. J’ai tenté d’évoquer ce sujet difficile en multipliant les angles d’attaque dans la série intitulée Langages viciés sur Stalker.
façon inéluctable, la corruption de l’homme, cette concaténation, finalement beaucoup plus logique que l’autre, pouvant être considérée comme l’unique matière véritable, profonde, de la guerre qu’un Karl Kraus mena contre la Presse, comme le but poursuivi illusoirement – la recherche d’un langage qui n’ait pas besoin d’être soutenu, persuadé, qui ne trahisse pas la réelle présence et s’en fasse même la promesse puis la diligente servante – par le génial Carlo Michelstaedter dans La persuasion et la rhétorique. C’est en perdant l’usage d’une parole non pas, bien sûr, prétendument pure, quelque impossible idiome édénique antérieur à la dramatique séparation entre les mots et les choses, mais, à tout le moins, consciente de sa puissance, de sa verte primitivité selon Kierkegaard et pouvant être façonnée par les grands écrivains, c’est donc non seulement en perdant cet usage mais bien davantage tout désir de posséder, dans l’appréhension du monde, un langage aussi riche que possible et non point quotidiennement défiguré, que l’homme perd son rang d’homme. J’ai tenté d’évoquer ce sujet difficile en multipliant les angles d’attaque dans la série intitulée Langages viciés sur Stalker.
Cercle Jean Mermoz : Pour reprendre la voie si altière de Cristina Campo dans Les Impardonnables, pensez-vous que face à ce « règne de l’indigence démesurée », il ne nous reste comme seule issue que la cartographie « des continents oubliés » ?
Juan Asensio : Ou bien aller nous réfugier dans les catacombes pour y retrouver, qui sait, quelque sens de la mesure, comme avait coutume de le répéter, après Bloy, Maurice G. Dantec ! En tout cas et à ma très modeste échelle, sans aucune publicité particulière de la part des médias consacrés (consacrés par qui, d’ailleurs ?) et avec le seul soutien de mes lecteurs qui, pour nombre d’entre eux, me soutiennent depuis plusieurs années, parfois presque depuis le début de Stalker, j’essaie de cartographier, à la diable et sans méthode rigoureuse car je ne suis qu’un dilettante passionné, des continents perdus, du moins quelques territoires c’est déjà cela de gagné, une tâche colossale que je remplis avec des fortunes diverses mais toujours modestes. Ah, parfois, l’horrible regret d’avoir volontairement évité une carrière professionnelle médiatique me saisit, et je me demande, avec un sourire plus ou moins sincère : que ne pourrais-je 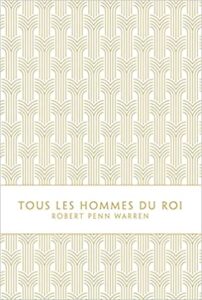 faire, que n’aurais-je pu réaliser, si j’avais disposé d’une page, moins que cela, de quelques colonnes réservées à l’évocation de ce qu’est la littérature, dans un quotidien national ? Puis je me ressaisis très vite en me donnant cette réponse, évidente et même, consolante : je n’aurais pas pu faire grand-chose de plus que sur mon blog et peut-être même bien moins, car quelque rédacteur en chef, lui-même servile servant d’un patron de journal devant rendre des comptes à quelque milliardaire profondément inculte n’aurait alors pas manqué de me taper sur les doigts et de me faire remarquer avec une moue de dépit ennuyé qu’il est parfaitement inutile d’évoquer, voyons !, les magnifiques romans de Paul Gadenne ou les textes, souvent incroyablement vifs et riches d’aperçus et d’analyse originaux, de Léon Daudet, auprès d’un « lectorat » se contentant de consommer les ouvrages de Leïla Slimani, Diane Ducret ou Édouard Louis ! Ainsi, je puis m’enorgueillir d’un ou deux minuscules exploits, comme celui d’avoir rappelé l’importance d’All The King’s Men (Les Fous du Roi puis Tous les hommes du Roi, chez Monsieur Toussaint Louverture) en tentant d’intéresser quelques éditeurs[1] au très grand Robert Penn Warren, honteusement ignoré par son éditeur historique, Stock, qui ne publie d’ailleurs plus grand-chose de très intéressant en matière de littérature nord-américaine voire de littérature tout court, et c’est aussi par la note que j’avais écrite voici quelques années sur Le Centre perdu qu’Allia a découvert ce petit texte remarquable de Zissimos Lorentzatos et l’a réédité très récemment dans sa collection de poche.
faire, que n’aurais-je pu réaliser, si j’avais disposé d’une page, moins que cela, de quelques colonnes réservées à l’évocation de ce qu’est la littérature, dans un quotidien national ? Puis je me ressaisis très vite en me donnant cette réponse, évidente et même, consolante : je n’aurais pas pu faire grand-chose de plus que sur mon blog et peut-être même bien moins, car quelque rédacteur en chef, lui-même servile servant d’un patron de journal devant rendre des comptes à quelque milliardaire profondément inculte n’aurait alors pas manqué de me taper sur les doigts et de me faire remarquer avec une moue de dépit ennuyé qu’il est parfaitement inutile d’évoquer, voyons !, les magnifiques romans de Paul Gadenne ou les textes, souvent incroyablement vifs et riches d’aperçus et d’analyse originaux, de Léon Daudet, auprès d’un « lectorat » se contentant de consommer les ouvrages de Leïla Slimani, Diane Ducret ou Édouard Louis ! Ainsi, je puis m’enorgueillir d’un ou deux minuscules exploits, comme celui d’avoir rappelé l’importance d’All The King’s Men (Les Fous du Roi puis Tous les hommes du Roi, chez Monsieur Toussaint Louverture) en tentant d’intéresser quelques éditeurs[1] au très grand Robert Penn Warren, honteusement ignoré par son éditeur historique, Stock, qui ne publie d’ailleurs plus grand-chose de très intéressant en matière de littérature nord-américaine voire de littérature tout court, et c’est aussi par la note que j’avais écrite voici quelques années sur Le Centre perdu qu’Allia a découvert ce petit texte remarquable de Zissimos Lorentzatos et l’a réédité très récemment dans sa collection de poche.
Cercle Jean Mermoz : Dans ce merveilleux petit livre, Lorentzatos écrit que « l’art doit devenir de nouveau le travail grave qu’il a toujours été. L’art doit être baptisé dans les eaux de la foi ». Pour être le « levier d’Archimède capable de déboiter le monde » (p. 358), la littérature ne doit-elle pas, d’une manière ou d’une autre, recevoir une onction sacrée (voire sacrificielle, dans le cas du génial Carlo Michelstaedter) ?
Juan Asensio : Une onction sacrée ? Qu’elle commence, cette littérature française contemporaine à peu près morte, et, pour sa part miraculeusement sauvée des eaux (usées), à peu près inconnue du public, fût-il cultivé, qu’elle commence donc par avoir quelque chose  à dire, et se charge sans peur mais courageusement d’un vrai « travail grave », sans doute point vraiment différent de la tâche que devaient accomplir, selon Rimbaud, les « horribles travailleurs » qui viendront ou plutôt : devaient venir, comme nous l’assurait un peu trop naïvement le jeune poète pour apporter du nouveau, qu’elle ne se craigne pas littéraire, romanesque, poétique, théâtrale, au lieu de ne se contenter que de proposer une séance télévisuelle ou radiophonique de pignolades décomplexées pour amuser le public de crétins d’un François Busnel ou d’un Bernard Lehut, qu’elle se remette à faire cela, c’est-à-dire à redevenir sérieuse, profonde, essentielle, détachée des ridicules préoccupations sociétales et autres billevesées pétitionnaires pour la cause putride desquelles on ne craint pas de l’enrôler, qu’elle se remette à sonder non pas les sanisettes émotionnelles de l’égotisme le plus fétide, les bidets de l’expérience vécue mais les reins et les cœurs, qu’elle se remette à forer les profondeurs, et nous aurons bien assez le temps de la baptiser, ensuite, à toutes les sources !
à dire, et se charge sans peur mais courageusement d’un vrai « travail grave », sans doute point vraiment différent de la tâche que devaient accomplir, selon Rimbaud, les « horribles travailleurs » qui viendront ou plutôt : devaient venir, comme nous l’assurait un peu trop naïvement le jeune poète pour apporter du nouveau, qu’elle ne se craigne pas littéraire, romanesque, poétique, théâtrale, au lieu de ne se contenter que de proposer une séance télévisuelle ou radiophonique de pignolades décomplexées pour amuser le public de crétins d’un François Busnel ou d’un Bernard Lehut, qu’elle se remette à faire cela, c’est-à-dire à redevenir sérieuse, profonde, essentielle, détachée des ridicules préoccupations sociétales et autres billevesées pétitionnaires pour la cause putride desquelles on ne craint pas de l’enrôler, qu’elle se remette à sonder non pas les sanisettes émotionnelles de l’égotisme le plus fétide, les bidets de l’expérience vécue mais les reins et les cœurs, qu’elle se remette à forer les profondeurs, et nous aurons bien assez le temps de la baptiser, ensuite, à toutes les sources !
Propos recueillis par Camarade Henri
Notes :
[1] Tout récemment, c’est au tour du premier roman de Penn Warren, Le Cavalier de la nuit, d’avoir été réédité par Séguier.
Liens :
 Ernesto Sabato, Hommes et Engrenages (R&N 2019), préface de Juan Asensio
Ernesto Sabato, Hommes et Engrenages (R&N 2019), préface de Juan Asensio
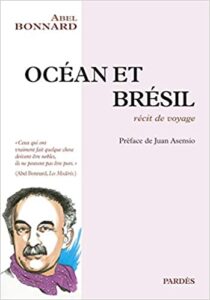
Abel Bonnard, Océan et Brésil (Pardès 2021), préface de Juan Asensio
 Arthur Machen, Les prémices du Mythe de Cthulhu Vol. 1 : Le Grand Dieu Pan (Editions Lumpen 2021), préface de Juan Asensio
Arthur Machen, Les prémices du Mythe de Cthulhu Vol. 1 : Le Grand Dieu Pan (Editions Lumpen 2021), préface de Juan Asensio
 Michel Bernanos, La montagne morte de la vie (L’Arbre Vengeur 2017), préface de Juan Asensio
Michel Bernanos, La montagne morte de la vie (L’Arbre Vengeur 2017), préface de Juan Asensio

(Source : Flickr Juan Asensio)