
21 mai 2022 par Jean Mermoz

21 mai 2022 par Jean Mermoz
[Peinture : L’Impesanteur, acrylique sur papier, Vadim Korniloff]
« Jeunes gens qui lisez ce livre, que vous l’aimiez ou non, regardez-le avec curiosité. Car ce livre est le témoignage d’un homme libre. » (Georges Bernanos, Les grands cimetières sous la lune)
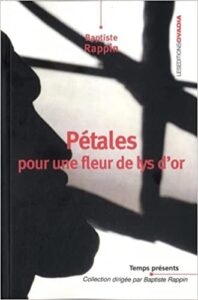 Universitaire et philosophe, Baptiste Rappin ne laisse pas, dans ses ouvrages comme dans ses conférences, de mettre en exergue les principes et les mécanismes de la société industrielle dont il estime qu’elle place l’humanité sur le chemin de son extinction. Nous le recevons à l’occasion de la parution de Pétales pour une fleur de lys d’or, publié aux éditions Ovadia en 2022.
Universitaire et philosophe, Baptiste Rappin ne laisse pas, dans ses ouvrages comme dans ses conférences, de mettre en exergue les principes et les mécanismes de la société industrielle dont il estime qu’elle place l’humanité sur le chemin de son extinction. Nous le recevons à l’occasion de la parution de Pétales pour une fleur de lys d’or, publié aux éditions Ovadia en 2022.
« Günther Anders définissait le « conservateur ontologique » dans les termes suivants : « C’en est arrivé à un tel point que je voudrais déclarer que je suis un «conservateur» en matière d’ontologie, car ce qui importe aujourd’hui, pour la première fois, c’est de conserver le monde absolument comme il est. […] nous devons être conservateurs au sens authentique, conservateurs dans un sens qu’aucun homme qui s’affiche comme conservateur n’accepterait ».
Or, quel péril menace de rendre le monde inhabitable ? Il s’agit bien de la société industrielle et de son dernier avatar, l’utopie cybernétique, qui organisent la prison digitale gérant l’intégralité de nos existences, de la maternité au cimetière, de l’entreprise au foyer, du corps à l’âme. Sa force destituante est telle qu’aucune institution n’échappe à son travail d’érosion, qu’aucun frein ne semble en mesure de lui opposer la résistance d’un contre-courant.
C’est en toute logique que le « conservateur ontologique » sera luddite et royaliste : luddite quand il s’agit de se cabrer devant l’empire technique du Réseau et de se rebiffer contre le principe de l’Efficacité ; royaliste afin de poser les premières pierres d’une nouvelle Fondation. Le conservateur ontologique ourdit, patiemment mais résolument, l’irruption du « Roi qui vient »» (Lodiciquarte des Pétales pour une fleur de lys d’or)

(Source : Flickr Juan Asensio)
Cercle Jean Mermoz : Votre dernier livre, Pétales pour une fleur de lys d’or, est dissonant par rapport à vos ouvrages précédents : la fine enquête généalogique du devenir organisation du monde de vos deux volumes de la Théologie de l’organisation est remplacée dans les Pétales par un chant analogique — éloge d’inspiration poétique qui poursuit la parole d’un Roi à venir. Le rythme même de l’ouvrage rompt avec les précédents : la scansion s’imprègne de liturgie, le thème se charge d’un souffle métaphysique et la prose se fracture par l’usage d’aphorismes et de scolies. Cette rupture est-elle un point de bascule de votre œuvre ou n’est-elle qu’un éphémère et éclatant épisode ?
Baptiste Rappin : Les deux volumes de la Théologie des Organisations présentent en effet une étude systématique du management et adoptent une écriture rationnelle, plutôt classique en sciences humaines et philosophie. Non pas pour se conformer au genre, ni encore pour satisfaire aux normes universitaires, ni enfin pour offrir au lecteur le confort d’une lecture linéaire. Le choix de cette écriture correspond avant tout à la nature même du règne planétaire du management qui recouvre le globe de l’homogénéité de ses processus. Décrire et analyser de façon systématique le management, c’est bien faire apparaître le management comme système, ce qu’il est en effet dès son coup d’envoi taylorien. Alors, quand il s’agit d’exposer le déchirement du tissu spatiotemporel des processus techniques, de se tourner vers la percée qui fend la continuité de l’enchaînement des boucles de rétroaction, il devient nécessaire de traduire cette brèche révolutionnaire dans une écriture de la discontinuité et de l’interruption. D’où le choix des fragments – les pétales – et de l’insertion de scolies et de citations afin de hacher et scander la lecture. On pourrait y voir une forme d’harmonie imitative, non pas dans le sens où les mots renverraient à un son réel, mais dans celui où la temporalité du texte essaie de faire ressentir et appréhender celle du Roi qui vient. Il ne faut donc pas voir dans ces choix d’écriture un goût ou une humeur personnel, mais bien une réponse à la nécessité de ce qui est exposé.
S’agit-il d’une bascule ou d’un tournant ? Je ne le formulerai pas ainsi, d’autant plus que je compte bien encore écrire quelques essais dans les années à venir. En revanche, il est évident que je pris une décision, ou qu’une résolution naquit en moi. Nombre de mes lecteurs attendent que je propose des « solutions » à l’enfer de l’arraisonnement techno-organisationnel que je décris : « que faire ? » me demandent-ils en me confondant très certainement avec un camarade léniniste. Mais répondre à cette question m’engagerait d’emblée à adopter le style de raisonnement ingénierique propre à l’univers carcéral managérial. Aussi est-il devenu pour moi une évidence que la perforation et l’éclatement du Réseau étaient les incontournables conditions d’un retour à la capacité instituante, lieu originaire d’élaboration des sociétés humaines par elles-mêmes : telle est la vocation profonde du messianisme anti-millénariste (ou de la sotériologie anti-eschatologique) du Roi qui vient.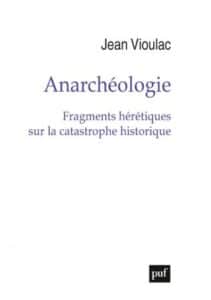
Je note enfin que le dernier livre de Jean Vioulac Anarchéologie, paru au printemps 2022, porte comme sous-titre « Fragments hérétiques sur la catastrophe historique » : là aussi l’écriture morcelée fait écho au craquèlement de la totalité cybernétique. Vioulac ne partage guère, je crois, mon inquiétude généalogique qui fonde mon appel à la figure royale, mais nos raisonnements respectifs convergent vers ce que Heidegger nommait l’Ereignis, l’événement révolutionnaire qui déchire l’Histoire comme l’éclair fend le ciel.
Cercle Jean Mermoz : Par-delà le simple appel à la figure royale, vous élargissez cette parole à la confrérie du « Révolutionnaire du Lys d’or ». Celle-ci, loin d’être de sang noble, est plutôt une émanation des marges de la société : « Pirates, flibustiers et hackers ; luddites et néo-luddites, canuts et néo-canuts ; communards et syndicalistes révolutionnaires ; camelots et cagoulards ; résistants ; paysans et mystiques; poujadistes et décroissants ; bonnets rouges et gilets jaunes. Le roi qui vient, loin de relever d’un temps utopique, est au contraire une « possibilité permanente ». » (p. 35) Est-ce à dire que, contre la révolution permanente incarnée par le management, vous promouvez la permanence d’une révolte enracinée ?
Baptiste Rappin : La société moderne, industrielle, aujourd’hui cybernétique et digitale, a totalement effacé le passé, à telle enseigne que l’on ne peut plus désormais parler de « tradition » au sens d’un passé vivant et vécu, au sens d’un passé collectif et subjectif qui se prolongerait et s’actualiserait dans le présent. Notre rapport au passé est intégralement objectivé, qu’il prenne la forme des froides et métalliques expositions muséales, celle de la sotte et touristique festivité folklorique, ou encore celle, savante et barbante, du savoir universitaire. Cette société, sous l’impulsion conjuguée du Capital et de l’État, a donc recouvert le monde vivant d’hier et lui a substitué son empire spatio-temporel. Du côté de la géographie le Réseau a tissé sa toile sur l’ensemble des territoires ; avec ses routes, ses rails, ses canaux, ses fibres, ses tuyaux, ses gaines et ses lignes, il met en relation chaque point de l’espace avec tout autre, créant ainsi une continuité et une homogénéité spatiales tout à fait inédites. Du côté du temps, l’Histoire subsume sous sa majuscule l’ensemble des histoires particulières dans un récit global dans lequel elles se trouvent enrôlées de force et soumises à la logique d’un processus, celui du Progrès, auxquelles beaucoup d’entre elles demeurent parfaitement étrangères. Elles sont pourtant sommées de rejoindre le temps occidental qui, tout comme le Réseau dans l’ordre de l’espace, dresse une continuité et une homogénéité événementielles, jadis ponctuées par les grandes phases de l’évolution de l’humanité, aujourd’hui rythmées par la succession sans fin des innovation techno-économiques. C’est ainsi que la cage de fer de la société industrielle, de laquelle, bien que se croyant libres, on ne sort point, émane de l’action conjuguée du Réseau et de l’Histoire.
 De ce point de vue, on reconnaîtra très facilement que nombre de conservateurs et de royalistes, ou de militants qui se qualifient comme tels, ne cessent de tourner en rond dans la cage du Spectacle ; à rêver de restauration, à se complaire dans la nostalgie d’un passé révolu, à se montrer fidèles à une famille et à une maison, à cultiver le culte des reliques, ils ne prennent pas conscience de leur inscription dans le rapport au passé installé et prescrit par la modernité. Eux aussi participent, assurément en dépit de leur volonté, à la pratique générale de l’empaillement, à tel point qu’ils bloquent l’avènement du Roi qui vient au même titre que tous les bonimenteurs de la société managériale. C’est pourquoi le Lys d’or, labyrinthe secret dont les allées et les traverses révèlent les affinités électives et les amitiés stellaires, se reconnaît dans et soutient toutes les entreprises de trouée du continuum spatio-temporel, irruptions spontanées que redoutent les pouvoirs publics comme en témoignent non seulement la fuite du Président de la République lors de l’abord du Palais de l’Élysée par les Gilets Jaunes, mais également la brutale répression dont ces derniers firent les frais dans les semaines suivantes.
De ce point de vue, on reconnaîtra très facilement que nombre de conservateurs et de royalistes, ou de militants qui se qualifient comme tels, ne cessent de tourner en rond dans la cage du Spectacle ; à rêver de restauration, à se complaire dans la nostalgie d’un passé révolu, à se montrer fidèles à une famille et à une maison, à cultiver le culte des reliques, ils ne prennent pas conscience de leur inscription dans le rapport au passé installé et prescrit par la modernité. Eux aussi participent, assurément en dépit de leur volonté, à la pratique générale de l’empaillement, à tel point qu’ils bloquent l’avènement du Roi qui vient au même titre que tous les bonimenteurs de la société managériale. C’est pourquoi le Lys d’or, labyrinthe secret dont les allées et les traverses révèlent les affinités électives et les amitiés stellaires, se reconnaît dans et soutient toutes les entreprises de trouée du continuum spatio-temporel, irruptions spontanées que redoutent les pouvoirs publics comme en témoignent non seulement la fuite du Président de la République lors de l’abord du Palais de l’Élysée par les Gilets Jaunes, mais également la brutale répression dont ces derniers firent les frais dans les semaines suivantes.
L’histoire de la société industrielle est parsemée de ces jaillissements imprévisibles, dont aucun, hélas, ne put inverser le cours de la catastrophe. Ce qu’ils montrent alors, ce n’est pas tant la permanence de la révolte que la permanence de sa possibilité, c’est-à-dire la possibilité toujours présente, aussi mince soit-elle dans l’empire réticulaire, d’un acte fondateur, ou d’une fondation, qui, puisant à la source d’un imaginaire constituant, déployant un verbe poétique et créateur, brise les barreaux de la cage de fer. Événement radical bien évidemment chargé de violence – nous ne pouvons ici faire l’économie des leçons de Machiavel –, la liste que vous donnez dans votre question suffit à l’attester.
Cercle Jean Mermoz : Ce jaillissement foudroyant n’est-il pas en contradiction avec le premier aphorisme de votre ouvrage, où vous écrivez que nous « sommes déjà morts ; […] Nous sommes les barbares d’après, les zombies du monde d’après, les morts-vivants d’après la catastrophe » ? À nous autres zombies du monde, ne nous reste-t-il pas comme ultime recours, non pas l’insurrection à venir (pour laquelle nous semblons déjà morts), mais plutôt le sabotage permanent ? (Pour faire écho à Philippe Muray, « L’empire du bien triomphe, il est urgent de le saboter »)
Baptiste Rappin : On ne cesse en effet d’anticiper la catastrophe, sociale, économique, climatique, nucléaire, comme si la dévastation du monde et la ruine de l’homme n’avaient pas déjà eu lieu. Dans des événements catastrophiques visibles, tels que ceux dont la Seconde Guerre Mondiale et les totalitarismes accouchèrent, mais également dans le cours ordinaire de la société industrielle et capitaliste d’où toute humanité – au sens de ce qui, dans l’homme, est irréductiblement humain – semble se retirer, non pas lentement et progressivement, mais au contraire avec une diabolique célérité. Nous sommes déjà morts, suspendus dans le temps de la fin de la fin, à l’image de ces personnages de cartoons qui continuent d’avancer dans le vide avant la chute finale. Nous survivons, corps et esprits, dans la dépendance de la grande perfusion du Réseau qui nous maintient dans le coma artificiel des simulacres postmodernes.
On peut le formuler d’une autre manière : de toutes celles que l’anthropologie a pu porter à notre connaissance, la société industrielle est la première des sociétés, et l’unique jusqu’à présent, dont le moteur est la destitution de toute institution, que je définirai ici brièvement comme l’instance normative et symbolique qui porte le discours de la légitimité. Elle prive de façon inédite ses membres de tout recours à un Tiers pour les plonger dans le grand bain de la fluidité organisationnelle.

Günther Anders
L’éventualité d’un retour à la vie, la très faible probabilité d’une deuxième résurrection, ne peuvent s’envisager qu’à partir d’un impératif catégorique que je qualifie de « luddite » : essaie d’agir, en chaque occasion, de telle sorte que tu sabotes le trafic ! Vie devient alors synonyme de retrait, de déconnexion, de freinage, de lenteur. C’est en effet le sabotage, comme le notait déjà Walter Benjamin, qui introduit la brèche dans l’espace-temps homogène du réseau, qui fissure le continuum et ouvre l’espace exigu d’où peut surgir non pas une innovation, qui n’est que la reproduction du même au sein du système cybernétique planétaire, mais une authentique création. Cela dit, la nécessité ontologique et politique du sabotage bute sur une question éthique que le langage courant traduit par la métaphore suivante : on ne fait pas d’omelette sans casser les œufs, posture morale assumée par Ted Kaczinsky dont les colis piégés firent plusieurs morts et blessés. Il y aurait fort à dire sur cette dimension éthique de l’acte révolutionnaire inéluctablement chargé de violence. Je me contenterai alors de dire ceci : je ne puis pour ma part imaginer un seul instant sacrifier des vies, dans la mesure où la vie est consubstantiellement liée à la création, qu’elle en est même la condition sine qua non. En revanche, et c’est ainsi que Günther Anders l’envisageait, la violence peut se déplacer de l’acte à l’intimidation, elle vise alors à insinuer la peur dans l’esprit des dominants.
Il faut enfin souligner que le ressort fondamental de la révolution, dans une société d’organisations qui ne cesse de destituer le monde et la cité, ne se situe pas du côté d’une radicalisation de la destitution – discours de la déconstruction qui montre là toute sa complicité avec la logique totalitaire du Réseau – mais d’une puissance d’institution. Et pour cela, nous n’avons jamais eu autant besoin de poètes maniant les images et les métaphores, les analogies et les correspondances, susceptibles de mobiliser, autour d’un nouveau Mythe, les compagnons du Lys d’or.
Cercle Jean Mermoz : Étonnamment, ce souci que vous exprimez à l’endroit des fondations mythiques à venir, n’est pas sans nous rappeler ce que vous écriviez dans vos précédents ouvrages sur l’analogie (La rame à l’épaule, Abécédaire de la déconstruction). En dernière instance, celle-ci n’est-elle pas le point fixe autour duquel votre œuvre, comme les Pétales, s’enroulent verticalement ?
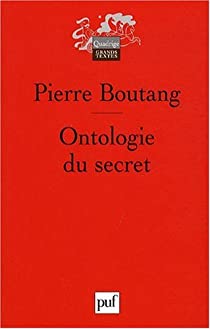 Baptiste Rappin : Je considère en effet, en emboîtant modestement le pas à d’autres penseurs (comme Pierre Boutang et Jean-François Mattéi), que l’analogie est la clef de voûte de la tradition occidentale, et aussi la garante que la rationalité instrumentale se relie à un horizon qui la dépasse, l’empêchant ainsi de sombrer dans la démesure. Elle a plus particulièrement pris la double forme de l’analogie d’attribution, qui n’est autre que le thème platonicien de la participation, et de l’analogie de proportionnalité, qui expose l’égalité des rapports qui structure le cosmos ainsi que la cité. L’analogie, comme le monde, a volé en éclat avec la révolution industrielle, et c’est désormais l’univocité du réseau qui gouverne et pilote les sociétés modernes. En d’autres termes, l’analogie ne peut plus être cet axe du monde autour duquel les Pétales pourraient s’enrouler verticalement, mais elle a peut-être gagné une profondeur horizontale que les Pétales tentent de mettre en perspective si ce n’est en relief.
Baptiste Rappin : Je considère en effet, en emboîtant modestement le pas à d’autres penseurs (comme Pierre Boutang et Jean-François Mattéi), que l’analogie est la clef de voûte de la tradition occidentale, et aussi la garante que la rationalité instrumentale se relie à un horizon qui la dépasse, l’empêchant ainsi de sombrer dans la démesure. Elle a plus particulièrement pris la double forme de l’analogie d’attribution, qui n’est autre que le thème platonicien de la participation, et de l’analogie de proportionnalité, qui expose l’égalité des rapports qui structure le cosmos ainsi que la cité. L’analogie, comme le monde, a volé en éclat avec la révolution industrielle, et c’est désormais l’univocité du réseau qui gouverne et pilote les sociétés modernes. En d’autres termes, l’analogie ne peut plus être cet axe du monde autour duquel les Pétales pourraient s’enrouler verticalement, mais elle a peut-être gagné une profondeur horizontale que les Pétales tentent de mettre en perspective si ce n’est en relief.
Je m’explique. L’analogie cosmique n’existe plus, c’est ainsi, regrettable certainement, manifeste à coup sûr. Il convient d’en prendre son parti : l’analogie nous reste, non plus comme rapport au lieu, mais comme rapport au temps. Elle est même le seul rapport authentique au temps envisageable quand toute tradition s’est évanouie, définitivement engloutie dans le progrès et l’innovation.
Les réactionnaires sont les chantres de la restauration : ils voudraient que les choses revinssent à leur état antérieur, ils appellent de leurs vœux une identité parfaite entre le passé et le présent. C’est évidemment peine perdue, l’événementialité de l’histoire étant par définition contraire à toute forme de répétition. Loin de se réduire à cette peau de chagrin de l’égalité des termes, l’analogie est source de création car elle est identité de rapports (a/b = c/d) ; dès lors, dire que l’analogie constitue désormais la seule modalité authentique de notre rapport au temps, c’est dire que l’histoire charrie des images, qui nous parviennent encore quoique difficilement, et qui peuvent faire écho à notre situation présente : ces images sont alors susceptibles de devenir une puissance d’effraction et un mythe mobilisateur.
À l’époque du déferlement technicien et managérial, de la toute-puissance capitaliste et de la stérilité de la déconstruction, les images du katéchon (la force qui retient, comme celle des luddites qui résistèrent à l’avancée machinique), de la kénose (le dépouillement de Dieu qui se fait homme) et du roi (comme figure généalogique) pourraient bien être la fragile promesse d’une nouvelle aube.
Propos recueillis par Camarade Henri

(Source : Flickr Juan Asensio)