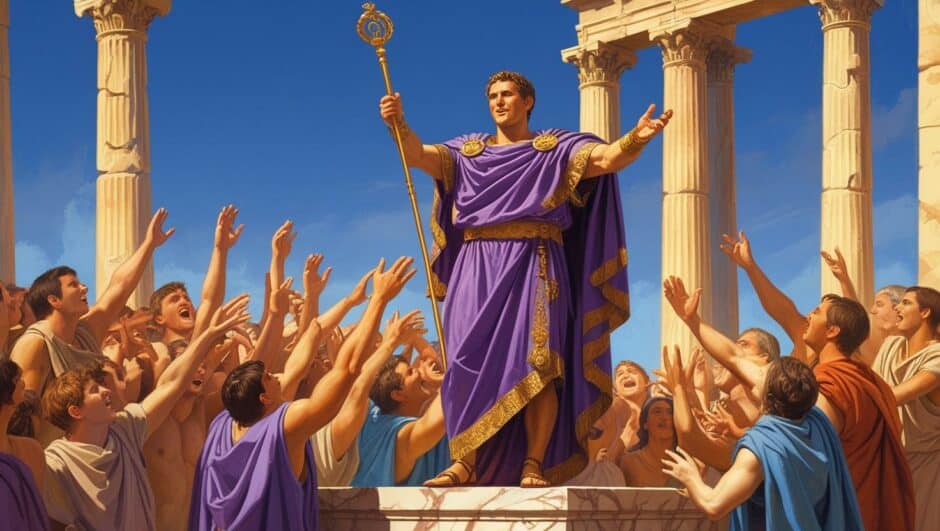
7 août 2025 par Jean Mermoz
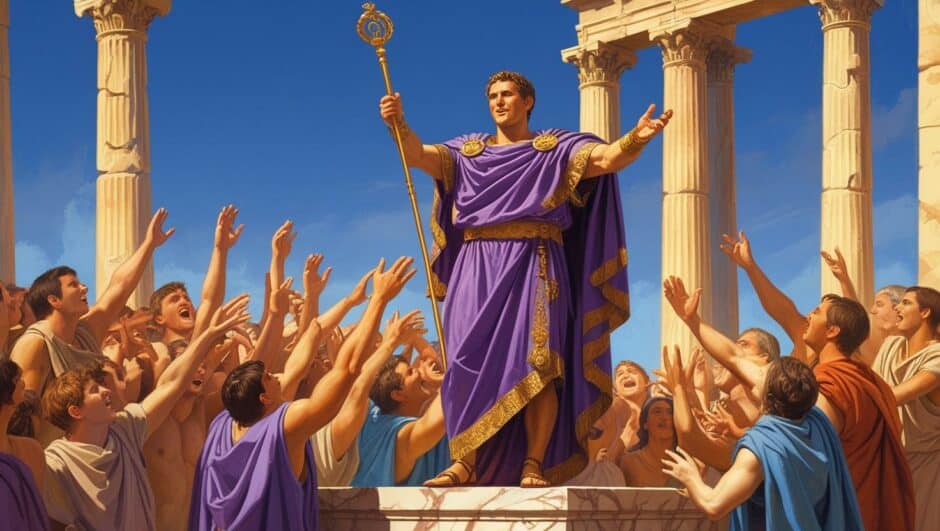
7 août 2025 par Jean Mermoz
Aristote évoque un autre moyen dont usent les tyrans les plus habiles pour se maintenir. Moins fréquent que le premier, il consiste à tromper le peuple quant à la nature réelle du pouvoir, en lui donnant les apparences d’un bon gouvernement. Dans la logique aristotélicienne, le tyran cherche donc à se parer des atours de la royauté, quand bien même il gouverne toujours en dépit de la volonté générale. « Le tyran peut […] se conduire comme un véritable roi, ou du moins en prendre adroitement toutes les apparences » (VIII, IX, §10).
Le tyran fait alors semblant de bien gérer les affaires publiques, en donnant l’impression qu’il est ingénieux, compétent, droit et juste. « D’abord, note Aristote, il paraîtra s’occuper avec sollicitude des intérêts publics, et il ne se montrera point follement dissipateur de ces riches offrandes que le peuple a tant de peine à lui faire, et que le maître tire des fatigues et de la sueur de ses sujets, pour les prodiguer à des courtisanes, à des étrangers, à des artistes cupides. Le tyran rendra compte des recettes et des dépenses de l’État, chose que du reste plus d’un tyran a faite ; car il a par-là cet avantage de paraître un administrateur plutôt qu’un despote ; il n’a point à redouter d’ailleurs de ne jamais manquer de fonds tant qu’il reste maître absolu du gouvernement » (§11). Le tyran dissimulateur peut ainsi s’appliquer à camoufler tous ses excès, tout en donnant l’impression qu’il rend des comptes à ses contribuables. Dans les faits, puisqu’il reste le maître du trésor public et du gouvernement dont il use pour son seul bien personnel, il n’en demeure pas moins despotique. Dans la même idée, Aristote ajoute : « D’un autre côté, en levant des impôts, des redevances, il faut qu’il semble n’agir que dans l’intérêt de l’administration publique, et seulement pour préparer des ressources en cas de guerre ; en un mot, il doit paraître le gardien et le trésorier de la fortune générale et non de sa fortune personnelle » (§12). L’apparence d’une saine gestion financière est ainsi indispensable.
En parallèle, le tyran qui trompe le peuple cherche toujours à inspirer le respect. « Il ne faut pas que le tyran se montre d’un difficile accès ; toutefois son abord doit être grave, pour inspirer non la crainte, mais le respect. La chose est du reste fort délicate, note Aristote ; car le tyran est toujours bien près d’être méprisé » (§13). Le philosophe ajoute : « pour provoquer le respect, il doit, même en faisant peu de cas des autres talents, tenir beaucoup au talent politique, et se faire à cet égard une réputation inattaquable. De plus, qu’il se garde bien lui-même, qu’il empêche soigneusement tous ceux qui l’entourent d’insulter jamais la jeunesse de l’un ou l’autre sexe » (VIII, IX, §13). Ainsi, pour espérer obtenir le respect des citoyens, le despote ne peut compter que sur son talent politique, sur sa capacité à simuler la dignité et sur la sauvegarde de sa réputation. De ce fait, il doit absolument se garder d’une conduite outrancière, notamment à l’égard des enfants. Aristote insiste particulièrement sur ce point : « Que le tyran, en ne se permettant jamais d’outrage d’aucun genre, en évite deux surtout : c’est de porter la main sur qui que ce soit, et d’insulter la jeunesse » (§17). Plus loin il écrit encore : « Si le tyran a quelques relations avec la jeunesse, il faut qu’il paraisse ne céder qu’à sa passion, et non point abuser de son pouvoir » (§18). Car tout écart discrédite le tyran auprès de ses sujets, lesquels peuvent se sentir insultés par ses agissements et atteints dans leur honneur, a fortiori s’il s’attaque à leurs enfants.
Le philosophe ajoute en outre que « cette circonspection est particulièrement nécessaire à l’égard des cœurs nobles et fiers. Les âmes cupides souffrent impatiemment qu’on les froisse dans leurs intérêts d’argent ; mais les âmes fières et honnêtes souffrent bien davantage d’une atteinte portée à leur honneur » (§18). Le tyran doit donc toujours se méfier des hommes habités par la dignité et la droiture, car ils sont les plus à-mêmes de le renverser au moindre faux pas. Aussi le tyran doit-il prendre toutes les dispositions pour ne pas froisser de tels hommes. « En général, dès qu’il peut y avoir apparence de déshonneur, il faut que la réparation l’emporte de beaucoup sur l’offense » (§17). Les hommes d’honneur, pourvus « d’âmes fières et honnêtes », forment ainsi la principale menace du pouvoir tyrannique[1]. Comme l’écrit Aristote : « Parmi les ennemis qui en veulent à la personne même du tyran, ceux-là sont les plus dangereux et les plus à surveiller, qui ne tiennent point à leur vie pourvu qu’ils aient la sienne. Aussi faut-il se garder avec la plus grande attention des hommes qui se croient insultés dans leur personne ou dans celle de gens qui leur sont chers. Quand on conspire par ressentiment, on ne s’épargne pas soi-même […] » (§18).
Le tyran qui se veut dissimulateur doit donc pouvoir se tenir et tenir ses gens, ou à tout le moins doit savoir cacher ses vices : « S’il aime le plaisir, qu’il ne s’y livre jamais comme le font certains tyrans […] qui, non contents de se plonger dans les jouissances dès le soleil levé et pendant plusieurs jours de suite, veulent encore étaler leur licence sous les yeux de tous les citoyens, auxquels ils prétendent faire admirer ainsi leur bonheur et leur félicité. C’est en ceci surtout que le tyran doit user de modération ; et s’il ne le peut, qu’il sache au moins se dérober aux regards de la foule. L’homme qu’on surprend sans peine et qu’on méprise, ce n’est point l’homme tempérant et sobre, c’est l’homme ivre ; ce n’est point celui qui veille, c’est celui qui dort » (§14).
Par ailleurs, le despote peut, pour gagner le respect de la foule, se présenter comme un dirigeant visionnaire, pieux et dévoué à sa tâche. Comme l’écrit Aristote : « Il faut qu’il embellisse la ville, comme s’il en était l’administrateur et non le maître. Surtout qu’il affiche avec le plus grand soin une piété exemplaire. On ne redoute pas autant l’injustice de la part d’un homme qu’on croit religieusement livré à tous ses devoirs envers les dieux ; et l’on ose moins conspirer contre lui, parce qu’on lui suppose le ciel même pour allié. Il faut toutefois que le tyran se garde de pousser les apparences jusqu’à une ridicule superstition » (§15).
Le tyran avisé doit également faire preuve de générosité, afin d’encourager ses sujets à le soutenir dans la perspective de juteuses récompenses : « Quand un citoyen se distingue par quelque belle action, il faut le combler de tant d’honneurs qu’il ne pense pas pouvoir en obtenir davantage d’un peuple indépendant » (VIII, IX, §15), écrit Aristote. A l’inverse, le despote en quête de popularité confiera à d’autres organes la charge de punir, tout en conservant pour lui-même la charge de récompenser. Ainsi Aristote écrit que le « tyran répartira en personne les récompenses de ce genre, et laissera aux magistrats inférieurs et aux tribunaux le soin des châtiments » (§15).
Toutefois, « tout gouvernement monarchique, quel qu’il soit, doit se garder d’accroître outre mesure la puissance d’un individu ; ou, si la chose est inévitable, il faut alors prodiguer les mêmes dignités à plusieurs autres ; c’est le moyen de les maintenir mutuellement » (§16). Le pouvoir tyrannique aura ainsi tendance à démultiplier les titres, les dignités, les honneurs et les charges, de façon à maintenir ceux qui le servent dans la rivalité et la concurrence. Le despote privilégiera toujours les êtres sans envergure, et ne donnera jamais de fonctions aux hommes courageux, par crainte qu’ils le renversent : « S’il faut nécessairement créer une de ces brillantes fortunes, que le tyran ne s’adresse pas du moins à un homme audacieux ; car un cœur rempli d’audace est toujours prêt à tout entreprendre » (§16). Ainsi le tyran préférera-t-il toujours un être oisif, placide et sans talent à un homme fougueux, vif et compétent.
Par conséquent, le pouvoir despotique ne prend pas nécessairement les formes extrêmes observées précédemment. Il peut simuler la droiture, l’honnêteté et la piété ; se prétendre agir en bon gouvernement, et faire mine de rendre des comptes ; dissimuler ses déviances, s’il ne peut les contenir ; se montrer généreux en vue de plaire à la foule ; et limiter les abus qu’il ne peut empêcher. Mais le voile du mensonge ne dure jamais longtemps ; et le pouvoir d’un seul, même sous une apparence vertueuse, n’en demeure pas moins excessif. Le tyran, par sa toute-puissance, reste par essence soumis à ses désirs, et tout ce qu’il possède suscite bientôt l’envie et l’exaspération. Si bien que, sous son apparente force, le pouvoir tyrannique est d’une extrême fragilité, et toujours finit par tomber, croulant sous le nombres des ennemis qu’il se crée.
[1] Aristote, Les Politiques, Livre VIII, Chapitre VIII, §13 : « Bien souvent on conspire par colère des mauvais traitements que l’on a personnellement éprouvés. Même des magistrats, des membres de familles royales ont tué des tyrans, ou du moins ont conspiré, pour satisfaire des ressentiments de ce genre. »