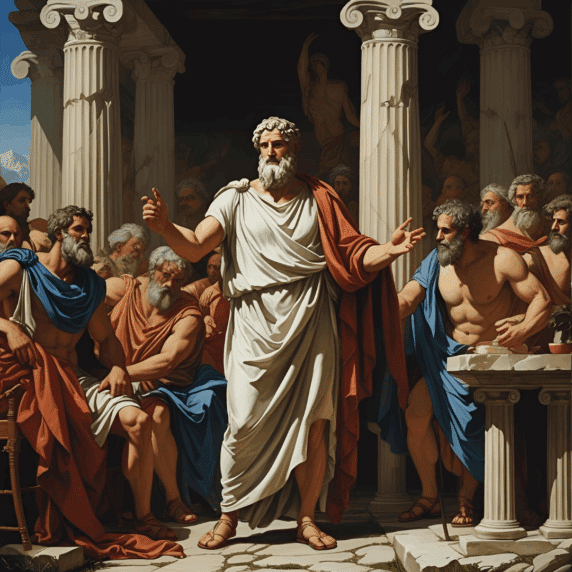
30 juillet 2025 par Jean Mermoz
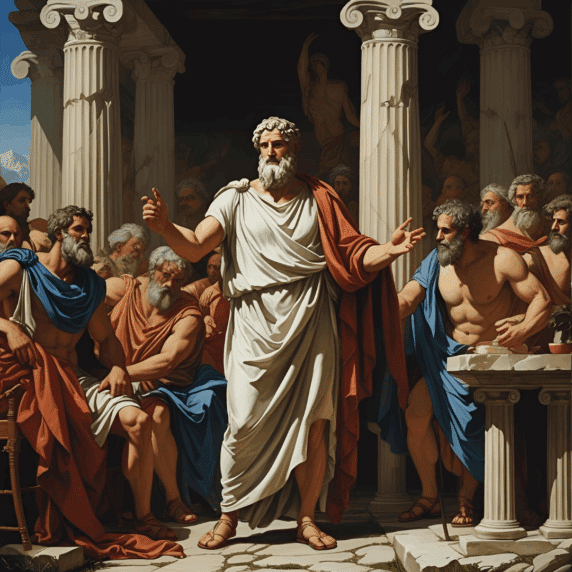
30 juillet 2025 par Jean Mermoz
La Politique d’Aristote tient une place fondamentale dans la pensée politique européenne. Ces réflexions portant sur les différents systèmes politiques et sur leurs formes « déviées » ont continuellement inspiré les grands penseurs du politique, de Saint-Thomas d’Aquin à Montesquieu, en passant par Machiavel.
Naturellement, la pensée d’Aristote (384-322 av. J.-C.) est celle d’un homme de son temps. Le philosophe grec décrit les systèmes politiques qu’il observe au IVème siècle avant notre ère, à savoir principalement les cités-Etats grecques et les empires barbares. Ces deux grandes formes de gouvernement qui caractérisent l’Antiquité sont différentes des nôtres. La cité-Etat grecque était une petite entité politique autonome qui se donnait ses propres lois, et au sein de laquelle les citoyens participaient plus ou moins directement au pouvoir politique. Ce modèle était le plus répandu dans la Grèce antique, et permettait de conserver une certaine liberté politique. A l’inverse, les empires antiques rassemblaient de nombreuses populations sous la domination d’un monarque très puissant, généralement divinisé. Celui-ci disposait d’importants pouvoirs et administrait les provinces de son empire de manière autoritaire. Entre le modèle de la cité-Etat et celui de l’empire, il n’existait pas nécessairement de juste milieu dans le monde antique. Notre Etat-nation moderne qui, malgré toutes ses limites, assure à la fois la puissance militaire des empires et la liberté politique des cités-Etats, n’existait pas encore.
A première vue, il pourrait sembler bien vain d’étudier la pensée d’Aristote, une pensée vieille de 2 300 ans, une pensée qui est celle du précepteur d’Alexandre le Grand, une pensée qui s’inscrit dans un cadre politique très antérieur à celui de l’Etat-nation. Pourtant, les réflexions d’Aristote ont toujours su trouver, à toute époque, une véritable résonnance. Certains auteurs, comme Machiavel au début du XVIème siècle, ont d’ailleurs entrepris d’actualiser et de compléter les observations d’Aristote dans un cadre plus moderne, en intégrant dans leurs réflexions des exemples qui leur étaient contemporains. Il est vrai que, dans un cadre occidental, la pensée du philosophe grec demeure intemporelle. Analysant finement les ressorts qui animent les individus et les communautés, notamment leurs passions et leurs intérêts, Aristote les intègre dans un raisonnement logique qu’il étaye par des exemples. Ses enseignements ne sont donc pas uniquement valables pour un Grec de son époque, mais pour toute société politique d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Aussi la description du pouvoir tyrannique proposée par Aristote n’a-t-elle rien perdu de sa substance : des despotes grecs aux régimes totalitaires du XXème siècle, en passant par quelques empereurs romains et autres princes de la Renaissance, les pouvoirs tyranniques, dans leur grande diversité, conservent néanmoins des traits semblables. De même, l’essence du pouvoir despotique, ses manifestations et les ressorts sur lesquels il s’appuie restent fondamentalement les mêmes de nos jours. Car le but du tyran, à savoir la domination absolue des corps et des esprits, n’a pas disparu ; et les moyens pour y parvenir n’ont pas changé. La tyrannie contemporaine se manifeste simplement à travers des formes plus complexes et plus subtiles de domination, mais leurs ressorts sont bien ceux que décrit Aristote. L’isolement, l’humiliation, la haine de soi, l’abrutissement, la manipulation, l’avilissement, l’insulte, la violence et la peur sont autant de moyens utilisés par le pouvoir despotique pour faire régner sa loi. Ainsi la domination d’un Etat sur un autre porte en elle les relents de la tyrannie ; de même que la domination d’une organisation supranationale ou d’une puissance étrangère sur un peuple a recours aux mêmes instruments que le despote. Naturellement, la pensée d’Aristote correspond plus directement à la domination d’un homme tyrannisant un collectif humain, ce qui ne peut que nous questionner quant à la nature de certains gouvernements, de certaines administrations et de certaines collectivités mais aussi de certains partis politiques, de certaines religions, de certaines entreprises et de certaines organisations marquées par des pratiques managériales douteuses. La volonté de dominer s’observe également dans le cadre de certaines familles, au sein de certains foyers et de certains couples, et emprunte parfois à la pratique tyrannique.
Si bien qu’en définitive, penser la tyrannie selon Aristote ne revient pas seulement à dépoussiérer un vieux traité de philosophie politique issu de la sagesse des Anciens. Il s’agit d’une réflexion des plus actuelles, portant sur une déviance fondamentale de l’être humain en société : la volonté de dominer, de soumettre et d’avilir l’autre pour s’en faire le maître absolu.
La pensée d’Aristote voit dans l’homme un « animal politique » qui, pour sa survie et sa perpétuation, doit nécessairement vivre en communauté. Tout l’enjeu de la politique, dès lors, consiste à organiser la vie commune dans le souci du bien commun. Ce qui est à l’avantage de toute la cité, l’intérêt commun, doit ainsi toujours primer sur les intérêts particuliers d’une faction. Dans son traité La Politique, Aristote s’interroge donc quant à savoir quel régime politique est le plus à-même de défendre l’intérêt général face aux intérêts particuliers, lesquels menacent de faire sombrer la communauté dans le chaos, le crime et l’iniquité.
Il considère ainsi trois grandes formes de gouvernement, à savoir le pouvoir d’un seul homme, le pouvoir de quelques-uns et le pouvoir de tous. Aristote constate alors que, pour chacune de ces organisations politiques, il existe une forme « droite », vertueuse et soucieuse du bien commun, et une forme « déviée », corrompue et prompte à la défense des seuls intérêts particuliers. La royauté (le gouvernement de l’honneur) s’oppose ainsi à la tyrannie (le gouvernement de la force), l’aristocratie (le gouvernement des meilleurs) se distingue de l’oligarchie (le gouvernement des plus riches) et le régime constitutionnel (politeia, le gouvernement de la loi) s’oppose à la démocratie (le gouvernement de la foule miséreuse)[1].
Quoi qu’il en soit, aux yeux d’Aristote, « la souveraineté doit appartenir aux lois fondées sur la raison […] Le magistrat, unique ou multiple, ne doit être souverain que là où la loi n’a pu rien disposer, par l’impossibilité de préciser tous les détails dans des règlements généraux » (III, VI, §13). De fait, toute la réflexion d’Aristote consiste à savoir comment garantir la souveraineté des lois fondées sur la raison pour maintenir l’unité, dans une communauté politique sans cesse tentée de céder aux sirènes des intérêts particuliers.
La pensée globale d’Aristote, souvent résumée ainsi, est en réalité plus nuancée. S’appuyant sur des exemples concrets appartenant à l’histoire des cités-Etats grecques, le philosophe observe des manifestations plus ou moins « extrêmes » des différents régimes politiques qu’il identifie, selon qu’ils menacent plus ou moins fortement l’intérêt général par la concentration ou la confiscation du pouvoir et la soumission ou non aux lois : l’oligarchie fondée sur l’hérédité des charges publiques est ainsi plus néfaste que l’oligarchie fondée sur le cens. Aristote intègre également des subtilités, en s’autorisant par exemple à qualifier un régime de mi-oligarchique, mi-démocratique. Il songe aussi au fait que la lettre d’une constitution peut différer de sa pratique, et qu’ainsi une constitution démocratique n’empêche pas nécessairement son gouvernement d’être oligarchique, si la « tendance des mœurs et des esprits » est oligarchique. De la même façon, de bonnes lois ne sont en rien une garantie de l’existence d’un bon gouvernement. Aristote observe également que les formes « déviées » ne sont pas uniquement le résultat d’une corruption des formes « droites », mais que les différents systèmes de gouvernements peuvent évoluer, s’imbriquer, se répondre et s’hybrider entre eux. Ainsi la tyrannie peut-elle tout autant procéder d’une monarchie corrompue ou d’une oligarchie violente que d’une démocratie sous l’emprise d’un démagogue.
[1] Aristote, Les Politiques, Livre III, Chapitre V, §4 : « Les déviations de ces gouvernements sont : la tyrannie, pour la royauté ; l’oligarchie, pour l’aristocratie ; la démagogie, pour la république. La tyrannie est une monarchie qui n’a pour objet que l’intérêt personnel du monarque ; l’oligarchie n’a pour objet que l’intérêt particulier des riches ; la démagogie, celui des pauvres. Aucun de ces gouvernements ne songe à l’intérêt général. »