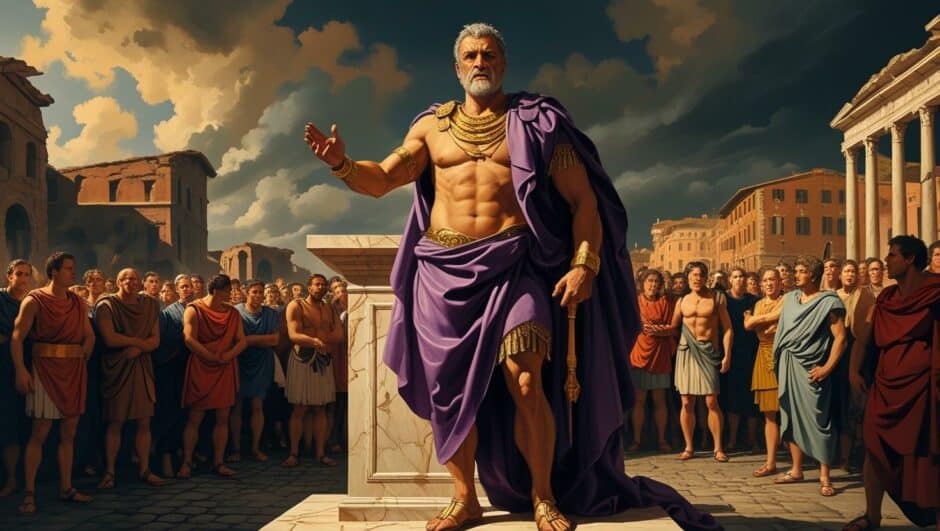
1 août 2025 par Jean Mermoz
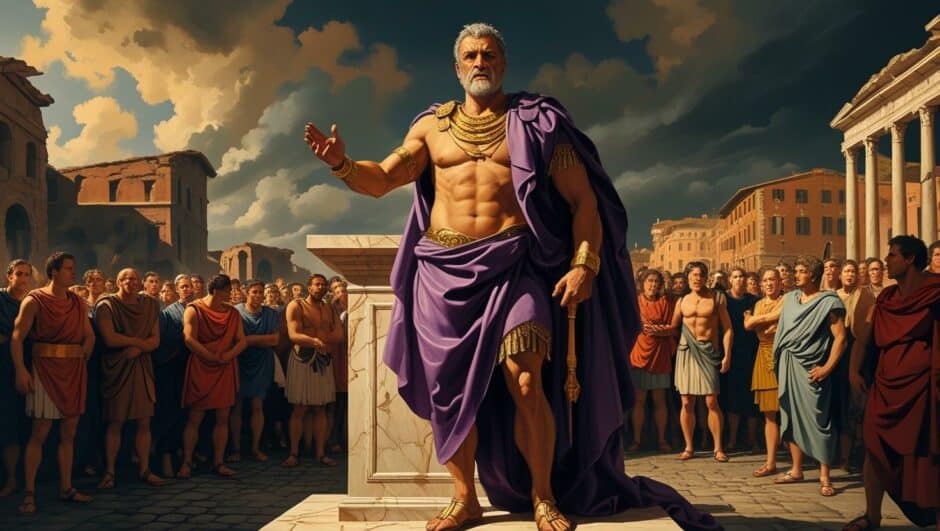
1 août 2025 par Jean Mermoz
De tous les régimes politiques identifiés par Aristote, la tyrannie tient une place bien particulière. Il s’agit du « pire des gouvernements, comme le plus éloigné du gouvernement parfait. En second lieu, vient l’oligarchie, dont la distance à l’aristocratie est si grande. Enfin la démagogie est le plus supportable des mauvais gouvernements » (VI, II, §2).
Le philosophe décrit la tyrannie comme « le gouvernement d’un seul homme, régnant en maître sur l’association politique » (III, V, §5) comme le maître règne sur ses esclaves. Pour Aristote, la tyrannie est ainsi le propre « des peuples poussés par un esprit naturel de servitude, disposition beaucoup plus prononcée chez les barbares que chez les Grecs, dans les Asiatiques que dans les Européens » (III, IX, §3). Ces peuples asservis « supportent le joug du despotisme sans peine et sans murmure », confiant à des rois pourtant légaux des prérogatives de tyrans. De cette « royauté barbare » héréditaire, Aristote distingue une autre espèce de monarchie aux allures tyranniques, que connaissaient les anciens Grecs : l’Aesymnétie (III, IX, §5). Ce régime d’exception, qui confiait temporairement à un seul homme élu des pouvoirs très étendus en vue de répondre à une situation de crise, est considéré par Aristote comme « une tyrannie élective ». Ainsi le despotisme se présente-t-il chez Aristote sous de nombreux visages, et l’élection d’un magistrat tout-puissant n’en fait pas moins un tyran.
Aristote, néanmoins, distingue une « troisième espèce de tyrannie qui semble mériter plus particulièrement ce nom, et qui correspond à la royauté absolue ». Ici le tyran, « loin de toute responsabilité et dans l’intérêt seul du maître, gouverne des sujets qui valent autant et mieux que lui, sans consulter en rien leurs intérêts spéciaux. Aussi est-ce un gouvernement de violence ; car il n’est pas un cœur libre qui supporte patiemment une semblable domination » (VI, IX, §3). C’est de cette forme de gouvernement que nous traiterons ici.
Pour Aristote, la tyrannie est contraire aux lois naturelles, car « le pouvoir absolu d’un seul n’est ni utile ni juste […] » (III, XI, §10). En outre, la tyrannie est, par nature, le régime du caprice, de la démesure et de l’impulsion car, à la souveraineté de la loi, il substitue « la souveraineté d’un individu, toujours sujet aux mille passions qui agitent toute âme humaine » (III, VI, §3). Autrement dit, pour Aristote, le despotisme ne saurait être au service de la raison, précisément parce qu’il confie tout le pouvoir à un seul homme en proie aux passions.
Le philosophe grec, au contraire, avance que plus le pouvoir est partagé entre un nombre important de citoyens, plus l’intérêt commun est à-même d’être défendu. Le partage des charges publiques, qu’Aristote appelle des « magistratures », est ainsi essentiel. De même, une certaine prépondérance de la classe moyenne est indispensable, car elle seule est capable de maintenir la paix civile entre, d’une part, une oligarchie soucieuse d’affirmer ses privilèges et, d’autre part, la masse des pauvres soucieuse de voler les plus riches au nom de l’égalité[1] (VI, X, §4). « Il faut ajouter encore, dit Aristote, que les bons législateurs sont sortis de la classe moyenne » (VI, X, §10).
Or, précisément, parce qu’il détient tout le pouvoir, le tyran « exagère […] le principe oligarchique », en bannissant l’écrasante majorité des citoyens des charges publiques (III, VI, §3). Il ne porte d’ailleurs aucun respect à la loi, qu’il viole volontiers et qu’il subordonne à ses ordres arbitraires. Le régime tyrannique n’aspire donc pas à faire respecter la loi qui, parce qu’elle relève de l’utilité commune, l’indiffère absolument. Il ne veille qu’à faire appliquer les desideratas du despote, lui assurant ainsi la conservation du pouvoir. Autrement dit, le tyran n’aspire pas à faire respecter la loi, mais bien à faire respecter sa loi.
L’archétype du tyran, chez Aristote, correspond donc à un chef illégitime et irresponsable qui, gouvernant à son seul profit, néglige l’intérêt supérieur de la communauté. Ce despote, usant et abusant d’un pouvoir tout-puissant, suscite la haine de ses sujets. Le pouvoir du tyran ne repose donc en fait que sur la violence et la crainte, et non sur la légitimité.
Pour Aristote, la tyrannie découle en premier lieu de la concentration « d’énormes pouvoirs dans une seule magistrature » (VIII, IV, §5). Dès lors, en effet, qu’un individu dispose de prérogatives importantes et étendues, fussent-elles légales, il ne peut qu’être tenté d’en abuser à son seul profit, « car le pouvoir est corrupteur, et tous les hommes ne sont pas capables de supporter la prospérité » (VIII, VII, §7). Cette réalité se vérifie d’autant plus lorsque les charges sont durables. « Quand on reste peu de temps en fonctions, explique Aristote, il n’est pas aussi facile d’y faire le mal que quand on y demeure longtemps. C’est uniquement la durée trop prolongée du pouvoir qui amène la tyrannie dans les États oligarchiques et démocratiques. Ou bien, de part et d’autre, ce sont des citoyens puissants qui visent à la tyrannie : ici les démagogues, là les membres de la minorité héréditaire ; ou bien ce sont des magistrats investis de quelque grand pouvoir, après qu’ils en ont joui longtemps » (VIII, VII, §4). Ainsi, les individus dépositaires d’une autorité politique considérable et gouvernant de longue date sont les plus à-mêmes de sombrer dans le despotisme.
Parallèlement, dans la pensée d’Aristote, le pouvoir tyrannique procède fondamentalement de l’extrême inégalité. Il écrit : « Partout où la fortune extrême est à côté de l’extrême indigence, ces deux excès amènent ou la démagogie absolue, ou l’oligarchie pure, ou la tyrannie ». Il ajoute : « la tyrannie sort du sein d’une démagogie effrénée, ou d’une oligarchie extrême, bien plus souvent que du sein des classes moyennes […] » (VI, IX, §8). Cette affirmation suppose, en premier lieu, que la tyrannie découle soit de l’accaparement du pouvoir par un démagogue flattant les petites gens, soit de l’accentuation à l’extrême du fait oligarchique. En second lieu, Aristote évoque la classe moyenne, « la seule qui ne s’insurge jamais » (VI, IX, §9), et la seule qui, n’aspirant qu’au calme et à la liberté de gérer ses propres affaires, est moins encline à appeler de ses vœux les tyrans. Pour cette raison, Aristote pense que la conservation de la moyenne propriété est essentielle à la stabilité et à la liberté politique de la cité. De fait, quel que soit le régime politique en place nous dit Aristote, « le législateur ne doit jamais avoir en vue que la moyenne propriété » (VI, X, §3).
Or, dans les oligarchies, la classe moyenne n’est pas épargnée, car les plus riches ne servent que leurs intérêts et évincent les autres des organes de décision. De fait, « le nombre de pauvres venant à s’accroître, sans que celui des fortunes moyennes s’accroisse proportionnellement, l’État se corrompt et arrive rapidement à sa ruine » (VI, IX, §9). L’oligarchie extrême, par les troubles intérieurs auxquels elle conduit, mène ainsi fatalement à un régime despotique, soit pour se maintenir face à la populace, soit comme réponse de la rue à tous ses excès. De plus, écrit Aristote, « les principes oligarchiques mènent droit à la tyrannie ; car si un individu est plus riche à lui seul que tous les autres riches ensemble, il faut, en suivant les maximes du droit oligarchique, que cet individu soit souverain ; car il a seul vraiment le droit de l’être » (VII, I, §12). La tyrannie peut ainsi naître du durcissement d’un régime oligarchique, dans lequel, par définition, « la décision de toutes les affaires est confiée à une minorité » (VI, XI, §6) et où « les riches et les nobles, en petit nombre, possèdent la souveraineté » (VI, III, §8).
L’oligarchie, en effet, peut prendre plusieurs formes qui, selon le degré d’exclusion de la majorité des citoyens vis-à-vis du pouvoir, la rendent plus ou moins supportable au commun des mortels. L’oligarchie peut ainsi se caractériser par l’existence d’un cens plus ou moins coûteux ; par la réservation des charges publiques à un cercle restreint, voire héréditaire ; ou, pire encore, par la captation de la souveraineté par les magistrats, qui se placent ainsi au-dessus des lois. Aristote appelle cette forme extrême de l’oligarchie « dynastie » ou « gouvernement de la force » (VI, V, §1). Evoquant la constitution de Sparte, le philosophe énumère d’autres éléments qu’il qualifie « d’oligarchiques », en observant que « toutes les fonctions y sont électives ; pas une n’est conférée par le sort ; quelques magistrats en petit nombre y prononcent souverainement l’exil ou la mort, sans compter encore d’autres institutions non moins oligarchiques » (VI, VII, §5). De même, les oligarchies peuvent se doter de « Commissaires » ou de « Gardiens des lois » chargés de confisquer la réalité du pouvoir suprême, en préparant d’avance toutes les délibérations, en réduisant le peuple à un rôle purement consultatif ou en réservant la décision suprême aux seuls magistrats (VI, XI, §9)[2]. En excluant ainsi un nombre croissant de citoyens de la vie politique, tous ces mécanismes oligarchiques favorisent par essence l’avènement d’un tyran.
Se fondant sur l’exemple des anciens Grecs, Aristote raconte comment l’aristocratie avait entraîné la chute de la royauté en vue d’instaurer la république, plus conforme à une meilleure répartition du pouvoir. Aristote suppose alors que ce gouvernement des meilleurs fut sujet à la corruption, laquelle « amena des dilapidations publiques, et créa fort probablement, par suite de l’estime toute particulière accordée à l’argent, des oligarchies. Celles-ci se changèrent d’abord en tyrannie, comme les tyrannies se changèrent bientôt en démagogies » (III, X, §8).
Aristote, en effet, identifie un lien très net entre tyrannie et démagogie, l’une s’apparentant volontiers à l’autre et réciproquement. Il écrit : « Dans les temps reculés, quand le même personnage était démagogue et général, le gouvernement se changeait promptement en tyrannie ; et presque tous les anciens tyrans ont commencé par être démagogues » (VIII, IV, §4). « C’était toujours en gagnant la confiance du peuple que tous arrivaient à leur but ; et le moyen de la gagner, c’était de se déclarer l’ennemi des riches » (VIII, IV, §5).
Le démagogue est ainsi celui qui, exploitant l’envie, la rancœur et la souffrance du petit peuple, s’empare de la puissance suprême par la tromperie et la manipulation. Pour flatter les foules, le démagogue se présente comme le grand champion de l’égalité, ainsi que l’explique Aristote : « La démagogie est née presque toujours de ce qu’on a prétendu rendre absolue et générale une égalité qui n’était réelle qu’à certains égards. […] Parce que tous sont également libres, ils ont cru qu’ils devaient être égaux d’une manière absolue » (VIII, I, §2).
Ainsi, le démagogue apparaît naturellement dans le régime de la foule (démocratie). Il peut également naître au sein d’une oligarchie, en se présentant comme le défenseur des classes inférieures victimes de l’oppression des riches. Le démagogue peut lui-même appartenir à la classe oligarchique, et ainsi user de son influence sur les masses pour renverser un système qui ne lui profite pas suffisamment (VIII, V, §4). Cependant, le démagogue est avant tout l’homme qui s’élève dans les démocraties les plus corrompues, « où la loi a perdu la souveraineté » au profit des décrets populaires (VI, IV, §4). « En effet, dans les démocraties où la loi gouverne, il n’y a point de démagogues, et les citoyens les plus respectés ont la direction des affaires » (VI, IV, §4), écrit Aristote. Or les démagogues ont tout intérêt à substituer la souveraineté des décrets à celle des lois, « car leur propre puissance ne peut que gagner à la souveraineté du peuple, dont ils disposent eux-mêmes souverainement par la confiance qu’ils savent lui surprendre » (VI, IV, §6). Pour ce faire, les démagogues « rapportent toutes les affaires au peuple » (VI, IV, §6), c’est-à-dire, en fin de compte, à eux-mêmes. Dans ce régime, les démagogues, cherchant toujours à complaire à la foule comme le flatteur cherche à complaire au tyran, avilissent la liberté au profit de la licence, en accordant à chacun « la faculté de vivre comme bon lui semble. A cette condition, bien des gens ne demanderont pas mieux que de soutenir le gouvernement ; car les hommes en général préfèrent une vie sans discipline à une vie sage et régulière » (VII, II, §12).
En définitive, Aristote estime ainsi que, si « la royauté se rapproche de l’aristocratie », « la tyrannie se compose des éléments de l’oligarchie extrême et de la démagogie ; aussi est-elle pour les sujets le plus funeste des systèmes, parce qu’elle est formée de deux mauvais gouvernements, et qu’elle réunit les lacunes et les vices de l’un et de l’autre » (VIII, VIII, §1).
Faisant en quelque sorte la synthèse de sa propre pensée, Aristote revient sur les différents leviers qui amènent un homme à se faire tyran : « Presque tous les tyrans, on peut dire, ont été d’abord des démagogues, qui avaient gagné la confiance du peuple en calomniant les principaux citoyens. Quelques tyrannies se sont formées de cette manière quand les États étaient déjà puissants. D’autres, plus anciennes, n’étaient que des royautés violant toutes les lois du pays, et prétendant à une autorité despotique. D’autres ont été fondées par des hommes parvenus en vertu d’une élection aux premières magistratures, parce que jadis le peuple donnait à longue échéance tous les grands emplois et toutes les fonctions publiques. D’autres enfin sont sorties de gouvernements oligarchiques qui avaient imprudemment confié à un seul individu des attributions politiques d’une excessive importance » (VIII, VIII, §3). « Grâce à ces circonstances, l’usurpation était alors facile à tous les tyrans ; de fait, ils n’ont eu qu’à vouloir le devenir […] » (VIII, VIII, §4). Par conséquent, l’archétype du tyran chez Aristote est un individu disposant déjà d’un pouvoir considérable, qu’il tire d’une charge publique, d’une richesse personnelle ou d’une aura populaire. Il apparaît dans une société gangrenée par les inégalités les plus criantes, soit comme démagogue auprès des foules, soit comme incarnation de l’oligarchie violente soucieuse de conserver ses privilèges. Le tyran se présente donc comme le défenseur d’une partie de la cité contre l’autre, et use de sa position pour accroître sa puissance et ainsi faire de sa volonté la loi. Il ne sert, ce faisant, que ses intérêts personnels, et ne porte plus aucune considération au bien commun. Ses priorités sont tout autres. Concentrant tout le pouvoir entre ses mains, il ne songe plus qu’à le conserver. Dès lors, l’obsession du tyran n’est plus que de rester le maître de la cité comme il est le maître de ses esclaves. N’ayant nulle légitimité, il « s’impose malgré la volonté générale » (VIII, VIII, §23).
[1] Aristote, Les Politiques, Livre VI, Chapitre X, §4 : « La constitution n’est solide que là où la classe moyenne l’emporte en nombre sur les deux classes extrêmes, ou du moins sur chacune d’elles. Les riches n’ourdiront jamais contre elle de complots bien redoutables de concert avec les pauvres ; car riches et pauvres redoutent également le joug qu’ils s’imposeraient mutuellement. Que s’ils veulent un pouvoir d’intérêt général, ils ne pourront le trouver que dans la classe moyenne. La défiance réciproque qu’ils ont entre eux les empêchera toujours de s’arrêter à un pouvoir alternatif; on ne se fie jamais qu’à un arbitre ; et l’arbitre ici, c’est la classe intermédiaire. Plus la combinaison politique qui forme l’État est parfaite, plus la constitution a des chances de durée. »
[2] Aristote, Les Politiques, Livre VI, Chapitre XI, §9 : « Dans le système oligarchique, il faut, ou choisir à l’avance quelques individus dans la masse, ou constituer une magistrature […] dont les membres se nomment Commissaires et Gardiens des lois. L’assemblée publique ne s’occupe alors que des objets préparés par ces magistrats. C’est un moyen de donner à la masse voix délibérative dans les affaires, sans qu’elle puisse en rien porter atteinte à la constitution. Il est possible encore de n’accorder au peuple que le droit de sanctionner ainsi les décrets qui lui sont présentés, sans qu’il puisse jamais décider en sens contraire. Enfin l’on peut accorder à la masse voix consultative, en laissant la décision suprême aux magistrats » (VI, XI, §9).