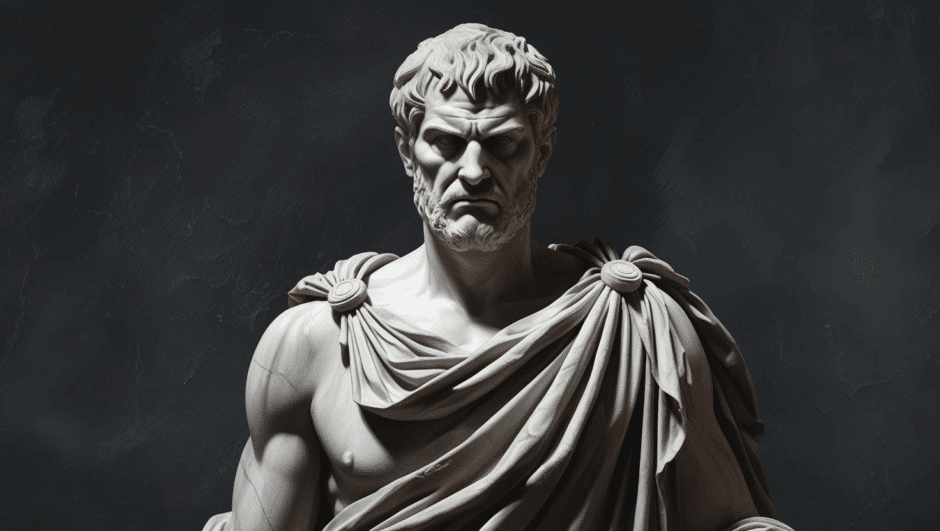
5 août 2025 par Jean Mermoz
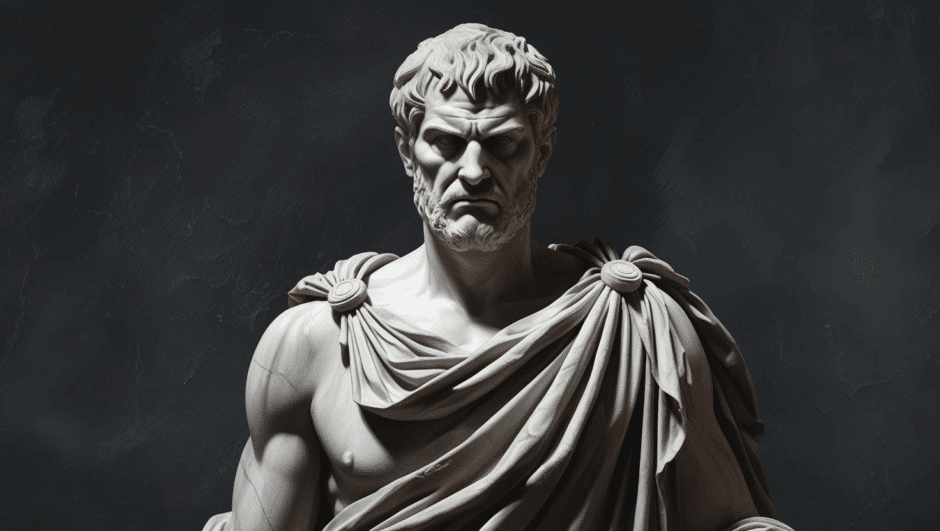
5 août 2025 par Jean Mermoz
Le tyran, par définition, « n’a jamais en vue, dans les affaires communes, que son intérêt personnel » (VIII, VIII, §6). Il est indifférent à l’intérêt supérieur de la communauté comme au bien de son peuple. Car le but ultime du tyran, nous dit Aristote, « c’est la jouissance ». Ne songeant qu’aux plaisirs que sa toute-puissance lui confère de manière illimitée, le pouvoir despotique se caractérise généralement par une attitude dépravée, animée par le vice, l’envie, la débauche et le caprice. Toutes les tentations pouvant être immédiatement assouvies, le tyran, ne supportant aucune résistance, succombe aisément à ses plus sombres passions. Le règne du tyran confine ainsi toujours au règne du vice.
Voulant ainsi tout posséder, le pouvoir tyrannique veille à asseoir son contrôle absolu sur les ressources de la communauté, qu’il utilise et considère comme les siennes propres. « Aussi, en fait d’ambition, le tyran songe-t-il surtout à l’argent » (VIII, VIII, §6), écrit Aristote. Le pouvoir despotique, en effet, « ne pense qu’à la richesse, qui nécessairement peut seule lui garantir la fidélité des satellites, et la jouissance du luxe » (VIII, VIII, §7). L’argent est donc le levier essentiel du régime tyrannique, non seulement pour la satisfaction des désirs personnels du despote mais aussi, et surtout, pour la conservation de son pouvoir. Le tyran n’étant pas légitime, sa domination ne repose que sur la contrainte, et sur des serviteurs capables de l’exercer avec violence. Le régime tyrannique se manifeste donc à travers des ordres arbitraires, qui ôtent toute souveraineté à la loi et oppriment les citoyens (VI, IV, §5).
La tyrannie, par sa nature fondamentalement oligarchique, se méfie du peuple (VIII, VIII, §7). Pour se maintenir, elle use de nombreux artifices afin d’avilir la population pour mieux la soumettre.
En premier lieu, le tyran « enlève le droit de posséder des armes » (§7). Le peuple, ainsi désarmé et intimidé face aux hommes du tyran, s’en trouve moins à-même de se soulever contre lui. Le pouvoir despotique peut ainsi brutaliser, humilier et appauvrir ses sujets, tout en conservant la suprématie martiale en vue de prévenir tout soulèvement populaire.
Favoriser l’isolement des individus est également le propre des systèmes despotiques. « Nuire au peuple, éloigner les citoyens de la cité, les disperser, sont des manœuvres communes à l’oligarchie et à la tyrannie » (§7). Le tyran, en particulier, va chercher à évincer les personnalités qui pourraient lui porter ombrage. Aristote évoque alors « ce système de guerre continuelle contre les citoyens puissants, cette lutte secrète et publique qui les détruit, ces bannissements qui les frappent sous prétexte qu’ils sont factieux et ennemis de l’autorité ; car elle n’ignore pas que c’est des rangs des hautes classes que sortiront contre elle les conspirations, que les uns ourdissent dans l’intention de se saisir du pouvoir à leur profit, et les autres, pour se soustraire à l’esclavage qui les opprime » (§7).
Toutefois, le tyran ne cible pas seulement les « citoyens puissants ». Il s’attaque à toutes les forces capables d’affaiblir son pouvoir, à commencer par l’intelligence. Aristote écrit ainsi que, pour conserver son pouvoir, le tyran s’évertue à « réprimer toute supériorité qui s’élève ; se défaire des gens de cœur ; défendre les repas communs et les associations ; interdire l’instruction et tout ce qui tient aux lumières, c’est-à-dire, prévenir tout ce qui donne ordinairement courage et confiance en soi » (VIII, IX, §2). Le régime tyrannique s’attache donc consciencieusement à détruire l’instruction du peuple, afin d’en altérer les capacités intellectuelles. Il combat l’érudition, la connaissance et la culture, en cela qu’elles dotent les hommes d’une conscience d’eux-mêmes. Il écarte tout autant les « gens de cœur » qui, doués d’une certaine force morale, sont toujours capables de lui tenir tête. Il interdit les « repas communs et les associations », où se manifeste la fraternité et le partage entre les citoyens. De la sorte, le despote aspire à régner sur une masse informe d’individus manipulables, sans cœur et sans esprit, incapables de lui nuire car incapables de prendre même conscience de leur avilissement. Le tyran, pour ce faire, s’emploie à briser l’estime que chaque individu se porte à lui-même, en réprimant toute forme de courage et de confiance en soi, de façon à étouffer d’avance toute entreprise envisagée contre lui.
En outre, le régime despotique veille à rompre tout lien de solidarité entre les citoyens, afin qu’ils ne puissent jamais s’associer contre lui. Le tyran s’emploie donc, comme l’écrit Aristote, à « empêcher les loisirs et toutes les réunions où l’on pourrait trouver des amusements communs » (VIII, IX, §2). Le régime despotique, d’une certaine façon, prive les sujets de toute joie de vivre, en frappant toutes les amitiés et tous les petits plaisirs de la vie. Pire encore, le tyran s’emploie à « tout faire pour que les sujets restent inconnus les uns aux autres, parce que les relations amènent une mutuelle confiance » (VIII, IX, §2). Pour que cette « mutuelle confiance » soit effectivement rompue au sein du corps social, le despote s’évertue à « semer la discorde et la calomnie parmi les citoyens ; mettre aux prises les amis entre eux ; irriter le peuple contre les hautes classes, qu’on désunit entre elles » (§4). Ainsi tout régime tyrannique cherche-t-il systématiquement à semer la zizanie, à créer artificiellement des tensions, des oppositions, des clivages et des ressentiments entre les citoyens, de sorte que l’unité populaire s’en trouve ébranlée et qu’ainsi toute résistance soit impossible. En d’autres termes, le pouvoir tyrannique isole, divise et dresse ses sujets les uns contre les autres, tout en leur retirant ce qui constitue leur joie de vivre.
« Le propre du tyran, poursuit Aristote, est de repousser tout ce qui porte une âme fière et libre ; car il se croit seul capable de posséder ces hautes qualités ; et l’éclat dont brilleraient auprès de lui la magnanimité et l’indépendance d’un autre, anéantirait cette supériorité de maître que la tyrannie revendique pour elle seule. Le tyran hait donc ces nobles natures, comme attentatoires à sa puissance » (§7). L’objectif du despote, par conséquent, n’est pas seulement d’isoler, de décourager, de décérébrer et d’asservir son peuple, mais également de l’avilir. Transformer les hommes libres en petits êtres vils, dépendants et inaptes à la liberté, étrangers à tout sentiment d’honneur, de fierté, de grandeur et de gloire, constitue le fondement du régime tyrannique. Les valeurs que le pouvoir despotique célèbre sont donc nécessairement opposées à celles-ci : la mesquinerie, la dépendance, la stupidité, la soumission, le zèle, l’indignité, l’abaissement, la petitesse et la suffisance deviennent ainsi la seule ligne de conduite autorisée. Aussi le tyran promeut-il systématiquement les êtres les plus ignobles au détriment des personnalités les plus dignes.
Le régime tyrannique, par ailleurs, impose une surveillance de tous les instants. Comme l’écrit Aristote, il s’agit de « bien connaître les moindres déplacements des citoyens, et les forcer en quelque façon à ne jamais franchir les portes de la cité, pour toujours être au courant de ce qu’ils font, et les accoutumer par ce continuel esclavage à la bassesse et à la timidité d’âme » (VIII, IX, §3). Empêcher les gens d’aller et venir à leur guise, contrôler leurs moindres faits et gestes et leur interdire de quitter le territoire constitue ainsi un levier de surveillance pour les régimes despotiques. Aristote en énumère d’autres : « savoir tout ce qui se dit, tout ce qui se fait parmi les sujets ; avoir des espions pareils à ces femmes appelées à Syracuse les délatrices ; envoyer, comme Hiéron, des gens pour tout écouter dans les sociétés, dans les réunions, parce qu’on est moins franc quand on redoute l’espionnage, et que si l’on parle, tout se sait » (VIII, IX, §3). Cette surveillance continue du peuple permet ainsi au tyran de pourchasser les hommes libres qui veulent encore lui résister, mais contribue tout autant à maintenir isolés ceux qui auraient fort intérêt à s’unir contre lui. Se sachant surveillés, les opposants s’abstiennent par eux-mêmes d’organiser la résistance, et pratiquent l’autocensure par crainte d’être entendus ou dénoncés. Par conséquent, la surveillance de masse constitue, pour le tyran une arme de domination et de terreur visant à pétrifier toute opposition.
Pour resserrer plus encore son emprise, le régime despotique paupérise sciemment sa population. Pour Aristote, « appauvrir les sujets » constitue rien moins qu’un véritable « principe de la tyrannie » (§4). Aristote y voit pour le tyran deux avantages : « d’une part, sa garde ne lui coûte rien à entretenir », puisque, face à la masse des miséreux, les satellites du despote seront toujours plus privilégiés, et ce à moindres frais ; « de l’autre, occupés à gagner leur vie de chaque jour, les sujets ne trouvent pas le temps de conspirer » (§4). Ainsi, pour le tyran, plonger la communauté dans la misère permet non seulement de gonfler les rangs de ses serviteurs, mais également d’asservir ses sujets par un travail dégradant, qui, en leur imposant de survivre au quotidien, les détourne de la chose politique. De plus, une population délibérément appauvrie devient nécessairement plus sensible aux corruptions du tyran, qu’il peut alors présenter comme des générosités. Aristote, par ailleurs, souligne que la misère est une arme de domination des âmes et des corps. Il observe que « la pauvreté empêche de savoir commander, et qu’elle n’apprend à obéir qu’en esclave » ; de même que « l’extrême opulence empêche l’homme de se soumettre à une autorité quelconque, et ne lui enseigne qu’à commander avec tout le despotisme d’un maître » (VI, IX, §5). Parce que l’indigence dégrade les hommes, les occupe, les divise, les corrompt et les avilit, elle constitue pour le tyran un formidable moyen de disloquer plus encore le tissu social pour son profit personnel. Or, l’un des moyens les plus simples auquel a recours un tyran pour paupériser ses sujets, c’est d’établir un régime fiscal de prédation. D’un côté, l’impôt enrichit le despote en recherche perpétuelle d’argent frais à dilapider pour son plaisir ; de l’autre, il assomme les citoyens en vue de les maintenir dans la misère. Aristote évoque ainsi le cas de Syracuse qui, en cinq ans, « absorbait par l’impôt la valeur de toutes les propriétés » (VIII, IX, §5).
Une autre grande caractéristique du tyran est d’être un fauteur de guerre. Comme l’écrit Aristote : « Le tyran fait aussi la guerre pour occuper l’activité de ses sujets, et leur imposer le besoin perpétuel d’un chef militaire. » Il s’agit donc toujours de donner au peuple une occupation qui l’empêche de conspirer contre le pouvoir, et de s’imposer à la communauté comme un chef indétrônable. L’état de guerre, qui plus est, profite largement à ceux qui gouvernent, dans la mesure où il leur confère durablement des pouvoirs considérables relevant normalement du droit d’exception. Le tyran ne peut que savourer une telle situation.
Ainsi, le régime tyrannique se caractérise par une profonde méfiance vis-à-vis du peuple, qu’il cherche à désarmer, à abrutir, à diviser, à avilir, à isoler et à appauvrir. Le pouvoir tyrannique est donc le pire des régimes possibles, en cela qu’il aspire, par tous les moyens, à briser la volonté pour en faire une soumission, à briser le collectif pour en faire une masse, à briser l’homme libre pour en faire un esclave.
Aux yeux d’Aristote, le pouvoir tyrannique ne peut attirer à lui que des êtres malfaisants, au premier rang desquels figure le flatteur. « Près du peuple, écrit le philosophe, on trouve le démagogue, qui est pour lui un véritable flatteur ; près du despote, on trouve ses vils courtisans, qui ne font qu’œuvre de flatterie perpétuelle » (VIII, IX, §6). Or, pour Aristote, seuls des êtres abjects acceptent de plaire, de complaire et de flatter le tyran pour en retirer des avantages. « Aussi la tyrannie n’aime-t-elle que les méchants, précisément parce qu’elle aime la flatterie, et qu’il n’est point de cœur libre qui s’y abaisse. L’homme de bien sait aimer, mais il ne flatte pas » (§6). Ainsi, à l’instar du despote, ceux qui l’entourent sont prêts à tout pour se maintenir. Le pouvoir tyrannique n’appelle donc à lui que des individus avides, ambitieux et perfides, capables de toutes les bassesses et de toutes les immondices. Ce dernier point, d’ailleurs, constitue un atout aux yeux du tyran, car, comme l’écrit Aristote, « les méchants sont d’un utile emploi dans des projets pervers » (§6). De fait, le tyran s’entoure toujours des pires crapules, qu’aucune force morale ni qu’aucun caractère ne retient de flatter, de ramper et d’obéir, même aux pires injonctions. Ainsi nomme-t-il à tous les postes de pouvoir de petits êtres vils, zélés, artificieux et cruels, que le tyran tient pour incapables de devenir un jour ses rivaux. Il est à penser que de tels individus privilégient à leur tour leurs propres favoris, de sorte que bientôt toutes les charges publiques sont détenues par des imposteurs. Le despotisme privilégie ainsi les hommes sans talents, sans courage et sans envergure car, comme l’écrit Aristote, « la tyrannie ne se maintient que par une perpétuelle défiance de ses amis, […] elle sait bien que, si tous les sujets veulent renverser le tyran, ses amis surtout sont en position de le faire » (§5). La solitude, la vigilance et la paranoïa sont ainsi d’autres attributs permanents du pouvoir tyrannique.
Outre les alliés, fort peu recommandables, qu’il se donne dans son plus proche entourage, le tyran s’en fait également au sein même de la population. Pour ce faire, le pouvoir despotique favorise toujours les êtres les plus dociles, les plus soumis et les plus conformes, en multipliant les licences à leur endroit. Ces licences ne sont en rien des libertés : elles y ressemblent, elles s’en réclament, mais en réalité elles étouffent la véritable liberté. Les licences, en effet, n’émancipent pas les individus, ne leur donnent pas la capacité d’agir selon leur propre volonté et ne leur concèdent aucune responsabilité. Au contraire, elles suppriment toutes les restrictions, toutes les barrières et tous les interdits, laissent libre-cours aux plus vils instincts, tout en déresponsabilisant les individus qui s’en réclament. Mues par l’abus et l’excès, les licences des uns réduisent les libertés des autres, précisément parce qu’elles contreviennent à la coexistence, à la paix et à l’harmonie qui doit régner au sein de toute communauté. Procédant d’une véritable inversion des valeurs et d’une déstructuration du corps social, qui s’en trouve ainsi plus divisé encore ; les licences donnent la préséance aux actes les plus ignobles, tout en les gratifiant du nom de liberté. Aussi l’honnête citoyen qui ose les remettre en cause peut-il être accusé de vouloir attenter aux libertés. C’est pourquoi, par nature, le régime tyrannique multiplie les licences : afin de tuer la liberté.
A l’évidence, le tyran n’accorde ces licences qu’aux catégories de personnes qu’il n’a pas à craindre. Il les attribue donc aux êtres les plus dociles, les plus conformes et les moins versés à la chose politique. Aristote évoque ainsi la « licence accordée aux femmes dans l’intérieur des familles pour qu’elles trahissent leurs maris ; [la] licence aux esclaves, pour qu’ils dénoncent aussi leurs maîtres ; car le tyran, ajoute-il, n’a rien à redouter des esclaves et des femmes » (VIII, IX, §6). Ainsi, la division que le tyran sème dans la cité ne frappe pas seulement la cohésion, la solidarité et l’amitié entre les citoyens. Elle cherche à s’immiscer dans les couples, dans les familles, dans les foyers, de façon à désorganiser l’ordre social, à reconfigurer toutes les relations et à inverser toutes les valeurs. Ainsi la licence, venant prendre la place de la liberté, étouffe les dernières forces de l’homme libre et referme d’autant plus sur lui le joug de la tyrannie.
De même, puisque le tyran se méfie des citoyens, il use d’un recours massif aux étrangers. Aristote l’explique en ces termes : « C’est encore l’usage du tyran d’inviter à sa table et d’admettre dans son intimité des étrangers plutôt que des nationaux ; ceux-ci sont pour lui des ennemis ; ceux-là n’ont aucun motif d’agir contre son autorité » (VIII, VIII, §7).
Par nature, le pouvoir despotique se dresse en ennemi de son peuple, et fait tout pour lui nuire. Ne pouvant donc fonder sa force sur le concours des citoyens qu’elle opprime, la tyrannie s’appuie tout naturellement sur des étrangers. A ceux-ci elle confie ses basses besognes, et notamment celle qui consiste à terroriser la population par une violence arbitraire. Aristote précise ainsi que « la garde d’un roi se compose de citoyens ; celle d’un tyran, d’étrangers » (VIII, VIII, §6). Dans la même idée, il ajoute : « Ce sont des citoyens en armes qui veillent à la sûreté d’un roi ; le tyran ne confie la sienne qu’à des étrangers. C’est que là, l’obéissance est légale et volontaire, et qu’ici elle est forcée. Les uns ont une garde de citoyens ; les autres ont une garde contre les citoyens » (III, IX, §4). Par conséquent, le pouvoir tyrannique encourage toujours l’entrée de nombreux étrangers sur son territoire, précisément parce qu’il veut en user comme d’un instrument d’asservissement et de terreur contre son propre peuple.
Les étrangers, comme le dit Aristote, « n’ont aucun motif d’agir contre son autorité » (VIII, VIII, §7). N’étant pas liés au destin de la cité, ils sont indifférents à son sort, et ne se mêlent donc pas de politique. Le tyran peut d’autant plus asseoir sa domination que les étrangers qu’il emploie sont nombreux et imperméables aux idées de liberté. N’étant présents dans la cité que par appât du gain, ces étrangers n’aspirent ainsi qu’à maintenir le pouvoir du tyran qui leur concède de si grands avantages, et à pourchasser tous ceux qui s’opposent à lui. Leur dévotion au régime est donc totale, dès lors que celui-ci est capable de les payer.
Aristote, toutefois, souligne que « la diversité d’origine peut aussi produire des révolutions jusqu’à ce que le mélange des races soit complet. Le plus souvent, ces changements politiques ont été causés par l’admission au droit de cité d’étrangers domiciliés dès longtemps, ou nouveaux arrivants » (VIII, II, §10). Aristote expose de nombreux exemples de la Grèce antique pour illustrer son propos : « Les Achéens s’étaient réunis aux Trézéniens pour fonder Sybaris ; mais étant bientôt devenus les plus nombreux, ils chassèrent les autres, crime que plus tard les Sybarites durent expier. Les Sybarites ne furent pas, du reste, mieux traités par leurs compagnons de colonie à Thurium ; ils se firent chasser, parce qu’ils prétendaient s’emparer de la meilleure partie du territoire, comme si elle leur eût appartenu en propre. A Byzance, les colons nouvellement arrivés dressèrent un guet-apens aux citoyens ; mais ils furent battus et forcés de se retirer » (VIII, II, §10). Aristote donne d’autres exemples tout aussi éloquents : « Les Antisséens, après avoir reçu les exilés de Chios, durent s’en délivrer par une bataille. Les Zancléeus furent expulsés de leur propre ville par les Samiens, qu’ils y avaient accueillis. Apollonie du Pont-Euxin eut à subir une sédition pour avoir accordé à des colons étrangers le droit de cité. A Syracuse, la discorde civile alla jusqu’au combat, parce que, après le renversement de la tyrannie, on avait fait citoyens les étrangers et les soldats mercenaires. A Amphipolis, l’hospitalité donnée à des colons de Chalcis devint fatale à la majorité des citoyens, qui se virent chasser de leur territoire » (VIII, II, §11). Ainsi Aristote rappelle-t-il, par cette longue énumération d’exemples, que la venue de nombreux étrangers dans une cité peut contribuer à sa déstabilisation politique, à la guerre intérieure et au malheur de sa population. Le régime tyrannique, en encourageant la venue de nombreux étrangers, participe donc non seulement à l’asservissement de son peuple, mais aussi à la destruction de la cité toute entière, quoique ce ne soit pas son principal objectif qui n’est que de dominer.
Ainsi, le pouvoir tyrannique trouve toujours çà et là quelques soutiens, en dépit de la haine qu’il inspire à tout son peuple. Ne s’entourant que d’être vils dont il se fait des courtisans, le despote étouffe la liberté en multipliant les licences. Déstructurant l’ordre social pour mieux opprimer les hommes libres, il referme son étreinte sur toute la communauté en la peuplant d’étrangers indifférents à son sort. Disposant ainsi d’une masse d’individus totalement hermétiques aux idées de liberté, le tyran en use comme d’un instrument pour avilir, violenter, surveiller et contrôler ceux qui osent encore résister à son pouvoir.