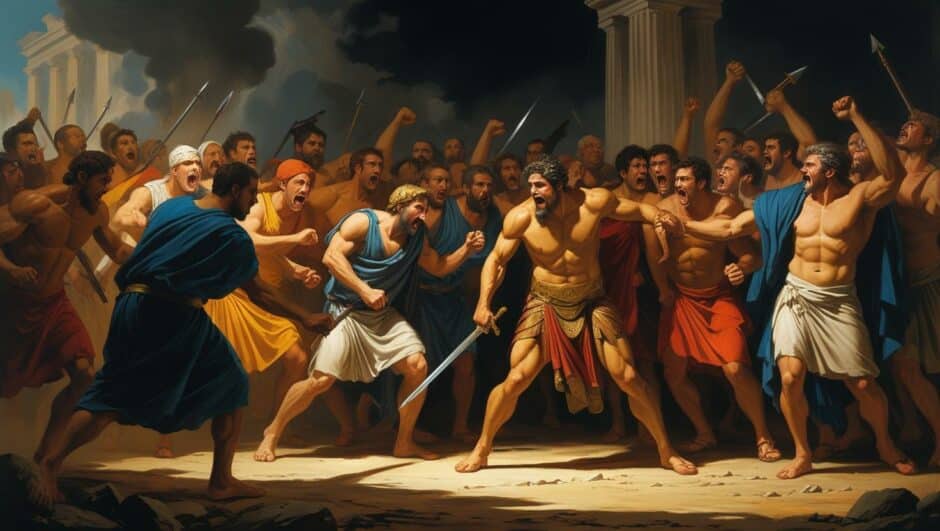
11 août 2025 par Jean Mermoz
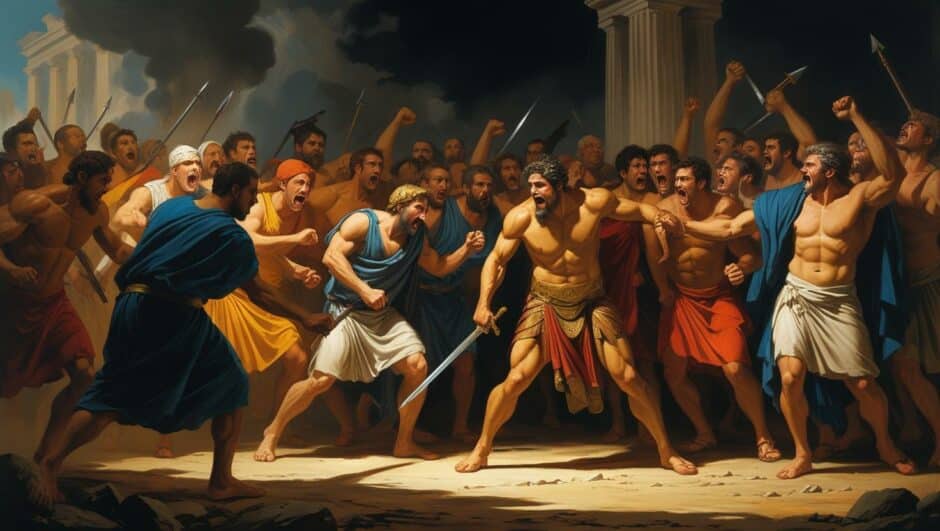
11 août 2025 par Jean Mermoz
Aux yeux d’Aristote, comme nous l’avons vu, « la tyrannie se compose des éléments de l’oligarchie extrême et de la démagogie » (VIII, VIII, §1). Aussi les causes qui entraînent la chute de ces deux régimes sont-elles les mêmes que celles qui précipitent la chute des tyrans : « Pour nous résumer, nous dirons que toutes les causes de révolution assignées par nous à l’oligarchie excessive et sans contre-poids, et à la démagogie extrême, s’appliquent également à la tyrannie ; car ces deux formes de gouvernement sont de véritables tyrannies divisées entre plusieurs mains » (§21).
Les phénomènes qui causent la chute des oligarchies, et donc des tyrannies, sont divers, selon Aristote. Le premier concerne l’excessive concentration du pouvoir.
Parce que la tyrannie ne réserve le pouvoir qu’à une infime minorité, composée du tyran et de son plus proche entourage, elle entraîne les bouleversements propres à l’oligarchie extrême. En premier lieu, cette excessive concentration du pouvoir entre quelques mains suscite la colère d’une partie de l’oligarchie : celle qui n’a pas l’oreille du tyran. Aussi Aristote rappelle-t-il que « les oligarques eux-mêmes, mais non pas ceux qui sont au pouvoir, poussent au changement, lorsque la direction des affaires est concentrée dans un très petit nombre de mains […] » (VIII, V, §2). Les oligarques ne bénéficiant pas du pouvoir tyrannique s’adonnent dès lors à conspirer pour s’emparer du gouvernement. Ainsi « l’oligarchie est perdue, lorsqu’une autre oligarchie surgit dans son sein. C’est ce qui a lieu quand le gouvernement entier n’étant composé que d’une faible minorité, les membres de cette minorité n’ont point cependant tous part aux magistratures souveraines » (§8). De même, la puissance excessive dont dispose le plus proche entourage du tyran avive toutes les rivalités entre les oligarques, qui profitent de leur position pour régler leurs comptes entre eux, y compris par la violence. Si bien que « souvent la sédition a pour cause les violences des oligarques eux-mêmes les uns envers les autres. Des mariages, des procès, sont pour eux des occasions suffisantes de bouleverser l’État » (§10).
Par ailleurs, si les oligarques évincés du gouvernement sont tentés de s’élever contre le pouvoir tyrannique ; Aristote ajoute que « bien des oligarchies se sont perdues par l’excès de leur despotisme, et ont été renversées par des membres du gouvernement même, qui avaient à se plaindre de quelque injustice » (§11). L’excès de confiance du tyran dans son propre pouvoir, la peur qu’il inspire autour de lui, le mépris qu’il a pour ceux qui l’entourent, les intérêts particuliers qu’il néglige, les décisions insensées qu’il prend, la nature incontrôlable de son pouvoir… sont autant de raisons qui peuvent pousser un proche soutien du tyran à le trahir. Selon les mots d’Aristote, « la tyrannie trouve dans son propre sein une […] cause de ruine, quand l’insurrection vient de ceux même qu’elle emploie » (VIII, VIII, §19).
En outre, le plus proche entourage du despote est, par définition, le plus à-même de contrôler le gouvernement. Aussi les êtres vils dont s’entoure le tyran peuvent-ils être tentés, non pas de renverser le régime despotique, mais d’en prendre le contrôle effectif, a fortiori lorsque le tyran est un faible. Aristote évoque ainsi la tyrannie fondée par Gélon, dans laquelle « Thrasybule, frère d’Hiéron, s’attachait à flatter toutes les folles passions du fils que Gélon avait laissé, et le plongeait dans les plaisirs pour régner sous son nom. Les familiers du jeune prince conspirèrent, non pas tant pour renverser la tyrannie même, que pour supplanter Thrasybule » (VIII, VIII, §19). La nature despotique d’un régime politique favorise, de fait, la multiplication des intrigues de cour, des rivalités oligarchiques et, partant, l’effritement du pouvoir tyrannique.
De même que l’injustice peut être à l’origine de la tyrannie, de même elle peut être source de sa chute. Cette injustice commence avant tout par une extrême iniquité sociale, iniquité que le pouvoir tyrannique ne peut qu’accentuer par sa propension naturelle à enrichir le proche entourage du tyran au détriment du reste de la société. De plus, le despotisme tenant à la fois de l’oligarchie extrême et de la démagogie, il cumule les travers des deux dans les oppositions qu’il nourrit. Comme le rappelle Aristote, « dans les oligarchies, les causes les plus apparentes de bouleversement sont au nombre de deux : l’une, c’est l’oppression des classes inférieures, qui acceptent alors le premier défenseur, quel qu’il soit, qui se présente à leur aide ; l’autre, plus fréquente, c’est lorsque le chef du mouvement sort des rangs mêmes de l’oligarchie » (VIII, V, §1). Ainsi, « la turbulence des oligarques qui se font démagogues » (§4) ou « qui se font les chefs des classes inférieures » (§5) fragilise le pouvoir des oligarchies, et donc nécessairement des tyrannies. De même, « lorsque l’oligarchie cherche à se trop concentrer ; ceux des oligarques qui réclament l’égalité pour eux sont forcés d’appeler le peuple a leur aide » (§6).
En outre, la nature profondément oligarchique du régime despotique, et la perfidie des êtres auxquels il confère le pouvoir, n’est pas sans susciter la révulsion des populations. Le tyran et ses acolytes bénéficient de tels privilèges que la communauté politique ne s’en trouve que plus exaspérée. « Quand les hommes qui gouvernent sont insolents et avides, on se soulève contre eux et contre la constitution qui leur donne de si injustes privilèges, qu’ils fassent d’ailleurs fortune aux dépens des particuliers ou aux dépens du public. Il n’est pas plus difficile de comprendre quelle influence les honneurs peuvent exercer, et comment ils peuvent causer des séditions. On s’insurge quand on se voit privé personnellement de toute distinction, et que les autres en sont comblés. Il y a une égale injustice quand les uns sont honorés, les autres avilis hors de toute proportion ; il n’y a réellement justice que si la répartition du pouvoir est en rapport avec le mérite particulier de chacun » (VIII, II, §4). Or justement, le propre de la tyrannie consiste à ne pas répartir le pouvoir selon les mérites, mais uniquement selon les complaisances du despote.
Par ailleurs, « l’inconduite des oligarques, dilapidant leur fortune personnelle par des excès » (§6) constitue une autre fragilité de l’oligarchie décadente, que l’on peut donc trouver dans le régime despotique. « Une fois ruinés, [ces oligarques dépensiers] ne songent plus qu’à une révolution » (§6), qu’ils voient comme un moyen de reconstituer leur fortune aux dépens du contribuable. « Parfois, au lieu de renverser la constitution, les oligarques ruinés pillent le trésor public ; et alors, ou bien la discorde se met dans leurs rangs, ou bien la révolution sort des rangs même des citoyens, qui repoussent les voleurs par la force » (§7).
De la même façon, Aristote exhorte tout régime politique soucieux de perdurer de « bien faire en sorte, par la législation ou tout autre moyen aussi puissant, que les fonctions publiques n’enrichissent jamais ceux qui les occupent. […] La masse des citoyens ne s’irrite pas autant d’être exclue des emplois, exclusion qui peut être compensée pour eux par l’avantage de vaquer à leurs propres affaires, qu’elle s’indigne de penser que les magistrats volent les deniers publics ; car alors on a deux motifs de se plaindre, puisqu’on est à la fois privé et du pouvoir et du profit qu’il procure » (VIII, VII, §9). Or, le pouvoir tyrannique consiste précisément à obtenir de tous les dépositaires des charges publiques un soutien constant au régime : l’enrichissement personnel, à tous les niveaux de l’administration, devient alors un élément déterminant de la mise au pas de l’appareil administratif.
« La supériorité est aussi une source de discordes civiles, quand s’élève l’influence prépondérante soit d’un seul individu, soit de plusieurs, dans le sein de l’État ou du gouvernement lui-même […] » (VIII, II, §4). Or qu’est-ce que la tyrannie sinon précisément l’élévation d’un seul individu ou d’une infime fraction à la tête du gouvernement ?
Ainsi, tous ces mécanismes qui contribuent au renversement des oligarchies, peuvent renverser de la même façon le régime tyrannique, qui n’est qu’une oligarchie concentrée à l’extrême.
Parallèlement, Aristote identifie chez certains tyrans les attributs du démagogue. Mais, dès lors, le despote qui s’essaie à la démagogie afin de mieux complaire à son peuple se retrouve empêtré dans les fragilités propres à la démocratie : il s’attire les foudres des plus riches. Aristote rapporte ainsi que « la marche la plus habituelle des révolutions dans la démocratie est celle-ci : tantôt les démagogues, voulant se rendre agréables au peuple, arrivent à soulever les classes supérieures de l’État par les injustices qu’ils commettent envers elles, en demandant le partage des terres, et en les chargeant de toutes les dépenses publiques ; tantôt ils se contentent de la calomnie pour obtenir la confiscation des grandes fortunes » (VIII, IV, §3). Ainsi le tyran qui, pour obtenir l’assentiment de la masse, use de démagogie ne peut que susciter l’indignation des riches, qui, en réaction, se coalisent contre lui. Grâce au pouvoir que leur confère leur fortune, ceux-ci deviennent dès lors de dangereux ennemis pour le tyran. Ainsi, la dérive démagogique ne sauve pas davantage le tyran que la dérive oligarchique et violente.
De plus, il convient de rappeler l’importance capitale que représente l’argent pour la survie du régime tyrannique. Aristote, en effet, assure que la tyrannie « ne pense qu’à la richesse, qui nécessairement peut seule lui garantir la fidélité des satellites, et la jouissance du luxe » (VIII, VIII, §7). Aussi bien pour ses plaisirs que pour sa sécurité, le despote est extrêmement dépendant de l’argent. Parce que ce régime ne se fonde ni sur la légitimité, ni sur l’allégeance, ni sur l’honneur comme le ferait une monarchie, la tyrannie ne trouve de soutiens que dans les intérêts matériels qu’elle parvient à satisfaire. Dès lors qu’il peut combler les appétits de son entourage de rapaces ; qu’il peut financer ses gardes pour sa sécurité ; et qu’il peut assurer de ses largesses chacun de ses serviteurs ; le tyran peut durer. En revanche, une fois que les excentricités du despote ont fini de dilapider toutes les ressources de la cité, il ne trouve alors plus personne pour le défendre de la colère du peuple.
Quoi qu’il en soit, l’un des plus grands adversaires du pouvoir tyrannique, c’est la haine que lui voue l’homme libre. Car, comme l’écrit Aristote, « des deux sentiments qui causent le plus souvent les conspirations contre les tyrannies, la haine et le mépris, les tyrans méritent toujours au moins l’un, c’est la haine » (VIII, VIII, §20). Le philosophe ne la dépeint pas comme un sentiment incontrôlé et irréfléchi à l’inverse de la colère qui, à ses yeux, « est toujours accompagnée d’un sentiment de douleur qui ne laisse pas de place à la prudence » (§21). Pour Aristote, le sentiment de « haine » que voue l’honnête citoyen au tyran est une « aversion [qui] n’a point de douleur qui la trouble dans ses complots » (§21) : c’est une sorte de rage de vaincre constante et persistance qui anime l’homme libre et qui, sans réfréner sa détermination, le pousse à la prudence, à la patience et à l’action.
La colère, à l’inverse, est la réponse passionnée du peuple aux insultes du tyran : « C’est surtout le ressentiment d’une insulte qui livre les cœurs aux emportements de la colère » (§21), écrit Aristote. « Les conspirations s’attaquent tantôt à la personne de ceux qui ont le pouvoir, tantôt au pouvoir lui-même. Le sentiment d’une insulte pousse surtout aux premières ; et comme l’insulte peut être de bien des genres, le ressentiment qu’elle provoque peut avoir autant de caractères différents. Dans la plupart des cas, la colère en conspirant ne songe qu’à la vengeance ; et elle n’est point ambitieuse » (§9). La haine de l’homme libre, elle, vise au renversement du pouvoir tyrannique en tant que tel. Aristote, en outre, insiste beaucoup sur le déchaînement de colère qu’un peuple peut manifester en réponse à une insulte du tyran. « L’injustice, la peur, le mépris, ont presque toujours déterminé les conspirations des sujets contre les monarques. L’injustice les a cependant causées moins souvent encore que l’insulte, et parfois aussi les spoliations individuelles » (VIII, VIII, §8), écrit-il.
Toutefois, pour Aristote, le plus grand péril qui puisse frapper un tyran n’est ni la haine, ni la colère, ni l’insulte, ni l’intrigue : c’est le mépris. Ainsi les despotes souffrent-ils moins d’être haïs ou craints que d’être méprisés de leur peuple, car « le mépris qu’ils inspirent amène fréquemment leur chute » (§20). Le pouvoir tyrannique, qui, parce qu’il est sans limite, s’abandonne à tous les excès, à tous les abus, à toutes les abjections et à toutes les immondices ; conduit facilement le despote à faire spectacle de ses perversions. Machiavel, qui plus est, a développé les traits qui conduisent un prince à être méprisé de son peuple, à savoir : « paraître inconstant, léger, efféminé, pusillanime, irrésolu »[1] (XIX, §4). Aussi les tyrans, « avilis par les dérèglements de leur conduite, […] tombent aisément dans le mépris et fournissent de nombreuses et excellentes occasions aux conspirateurs » (§20).
Par conséquent, le régime tyrannique cumule les vulnérabilités de l’oligarchie extrême et de la démagogie. Parce qu’il est inique, parce qu’il est brutal, parce qu’il est outrancier, le despotisme est en réalité un système politique extrêmement fragile. N’étant fondé que sur la force, il ne peut faire consensus autour de lui, faute de légitimité. Prenant nécessairement le parti des riches contre les masses ou des masses contre les riches, le tyran ne peut garantir la concorde des intérêts si chère à la stabilité politique d’une cité. Dans tous les cas, le pouvoir qu’il concentre entre ses mains suscite bientôt la convoitise et l’animosité des mécontents, qui se trouvent de plus en plus nombreux. Enfin, le ressentiment que nourrit l’homme libre à l’égard du tyran constitue un levier décisif de sa chute. Car une fois que son entourage l’abandonne, par crainte, par intérêt ou par déception ; une fois que l’oligarchie délaissée conspire contre lui ; une fois que ses dernières ressources sont épuisées, et que sa garde se dissout ; une fois que le peuple, insulté, est pétri du sentiment d’injustice ; l’honnête homme, animé par la rage de vaincre, n’a plus qu’à se saisir du tyran et à mettre fin à sa domination.
[1] Nicolas Machiavel, Le Prince, Chapitre XIX, paragraphe 4.