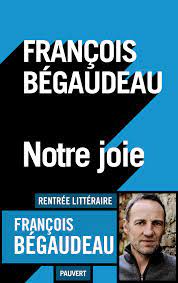
Notre joie
- Auteur : François Bégaudeau
- Date parution :
- Difficulté : 3 / 5
- Note : 4 / 5
- ISBN : 2720215708
- Edition : Fayard
Bégaudeau a sorti le mois dernier un essai, qui se veut la rectification à moitié romancée du précédent,
Histoire de ta bêtise. Ce qu’il veut rectifier ? Un malentendu.
Son précédent ouvrage était une diatribe contre la bourgeoisie de gauche. Elle qui se croit plus de gauche que bourgeoise, voire pas bourgeoise du tout et seulement de gauche, mais qui est en réalité en état d’auto-hypnose. C’est-à-dire que ce qu’il y a de gauche en elle n’est rien d’autre qu’une posture morale. Une posture de supériorité, et partant, très bourgeoise. Une histoire qu’elle se raconte. Une histoire pour se cacher qu’elle est bourgeoise, et qu’elle est peut-être encore plus bourgeoise du fait qu’elle se le cache. Elle est donc bête. Bégaudeau retraçait l’histoire de cette bêtise.
Alors, quel malentendu ? Le fait est que Bégaudeau, à plusieurs reprises (dont une qui sera la trame narrative de Notre Joie ; une rencontre avec un jeune « identitaire » du nom de M lors d’une soirée lyonnaise), a constaté qu’une partie de l’extrême-droite avait lu son livre non comme un essai contre une bourgeoisie qui se pense (à tort) de gauche mais comme un pamphlet contre la gauche. La bêtise, pour ces « identitaires », n’était donc pas celle du bourgeois qui se croit de gauche, mais de l’homme qui est de gauche, accessoirement bourgeois.
L’extrême-droite, lisant l’Histoire de ta bêtise, et constatant que Bégaudeau y descend la bourgeoisie de gauche, a donc suivi l’adage, dont l’écrivain s’efforcera de démontrer la fausseté au long des pages de son récit-essai, « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Il y aurait, par la désignation d’un ennemi commun, convergence entre l’extrême-droite qui n’aime pas la gauche, et l’extrême-gauche qui n’aime pas une gauche – qui est pour elle un centre, un extrême-centre. L’unique phrase de la quatrième de couverture est d’ailleurs : « Non, les extrêmes ne se rejoignent pas. »
Et pour cause. L’auteur commence par une analyse de la langue des deux camps, quand l’une dit « capital », l’autre dit « libéralisme ». Quand l’une dit « classes populaires », l’autre dit « peuple ». Quand l’une se garde de tirer des généralités abstraites et préfère le tangible, l’autre utilise pléthore de mots en -isme. Sans-frontiérisme, droit-de-l’hommisme… Et pas forcément négativement ; ce qui fait l’identité française pour les identitaires de la soirée lyonnaise, ce serait l’anti-imperialisme. Des mots, nous dit Bégaudeau, rien qu’un tissu de mots, qui forment un système flou, pas forcément cohérent, pas forcément incohérent, mais surtout, fondamentalement, essentiellement, idéel. Un système d’idée qui n’aurait pour but que de permettre des discours et des débats infinis, une surabondance de supputations et d’interprétations. Et qui jouit de ne rien expliciter, qui finalement aime dire à demi-mot ce que le « politiquement correct » lui interdirait de dire à haute voix. Qui cherche à embrouiller en se voulant au-delà des clivages, ni-de-droite-ni-de-gauche, ou un peu des deux. La même embrouille que l’extrême-centre, qui tient le même discours. Bégaudeau cite à juste titre Coluche : « Je ne suis pas de droite… Mais encore moins de gauche. » C’est vrai pour l’extrême- centre, c’est vrai pour les identitaires.
L’un des attributs de cette extrême-droite, c’est donc son idéalisme, le refus d’ancrer dans le réel les généralités qu’il profère, et qu’orientent bien plus des affects (négatifs) qu’une lecture rigoureuse des faits. Mais ce n’est pas le seul. Car celui-ci a pour corollaire que les identitaires ne cherchent pas en premier lieu à produire une analyse et un programme, ils cherchent avant tout à critiquer un discours, celui de la gauche, pour peu qu’elle soit bourgeoise ou pittoresque, et surtout pas sérieuse. La démarche de ce camp, c’est de prendre des ennemis faciles, car bêtes, et de se dire plus intelligents qu’eux, en inversant leurs propositions. Mentalité d’éditorialiste.
Mais Bégaudeau finit par s’amender. Pour préciser sa pensée. Ce n’est pas le discours qui vient en premier lieu. Ce n’est pas la langue de M qui lui a donné ses idées. Le camp qui contredit les idiots faussement (ou pas) de gauche n’a pas décidé de le contredire depuis nulle part. Non, l’écrivain nous dit bien que c’est toujours la question sociale qui prime, qui est le déterminant principal des comportements (déterminant qui englobe les autres mais qui ne les exclut pas). Il propose même une définition de la gauche : le camp qui pose la primauté de la question sociale. Il va même plus (trop ?) loin : « Il n’y a de politique que de gauche. Tout le reste est police. »
Quoiqu’il en soit, sa conclusion est claire : l’extrême-droite joue in fine pour le capital. Pour l’ordre établi. En ne nommant pas le problème, en préférant, quoiqu’elle prétende, faire jouer l’immatériel des valeurs contre le matériel de l’économique, en choisissant de parler de la question culturelle avant la question sociale, elle se range du côté des puissants, ceux qui dominent déjà.
Puis il en vient à la deuxième partie de son essai, où il laisse de côté le mince fil conducteur romanesque de son livre. Une fois la ligne de démarcation entre les extrêmes établis, après avoir clarifié sa position vis-à-vis des identitaires, il en vient à parler à son propre camp. La gauche, donc. Le « nous » de Notre joie. Et un peu de lui-même.
Il tente une critique de la gauche, d’une certaine gauche, mais cette fois réellement de gauche, par une autre gauche, incarnée en la personne de François Bégaudeau. Et c’est parfois là qu’il faiblit. Il abandonne par intermittences malheureuses son système politique, certes incarné comme il le revendique, pour de l’individualisme facile, qu’il n’arrive pas à revaloriser autrement qu’en parlant de lui. On a parfois affaire à un peu trop de convictions personnelles, et pas vraiment à de la pensée politique.
Et surtout, il ne cesse, comme il le faisait déjà, sans que cela pose problème, dans la première partie de l’essai (et comme tous le font, de l’extrême-gauche à l’extrême-droite en passant par l’extrême- centre), de se revendiquer du réel. Lui, il tient le réel, et pas les autres. On pourra argumenter qu’il démonte en effet assez bien ses opposants, qu’il est précis, qu’il est cohérent, et qu’il s’appuie sur des faits. C’est indéniable. Mais lorsque ses critiques en viennent à poser qu’il a le réel et que les autres non, sans le démontrer, d’un claquement de doigt, on voit la ficelle. L’artifice rhétorique. Et c’est dommage dans un essai qui évite le reste du temps les raccourcis et qui fait le pari presque toujours réussi d’une rigueur qui jamais ne perd son incarnation. On aurait envie de lui dire, en paraphrasant Giscard s’adressant à Mitterrand, qu’il n’a pas le monopole de la réalité.
Pour autant, il continue de clarifier les lignes de forces du champ politique actuel. Dont une chose essentielle : la gauche doit se soucier de l’individu, comme elle l’a toujours fait, comme elle l’oublie un peu en ce moment. Elle a tendance à l’oublier au profit du collectif, mais il lui faut garder à l’esprit que le collectif est un moyen – l’union fait la force – mais que ce moyen a toujours eu pour fin la défense d’individus, notamment des plus faibles. A ce titre, il nous invente un outil fort utile qu’il appelle la boussole sociale et qui postule que dans chaque situation, il faut se demander qui est l’opprimé. Qui l’est matériellement, individuellement. Ceci pour nous prévenir de retourner le problème migratoire sur le migrant, par exemple. C’est lui le faible de la situation, lui qui va se retrouver en situation de détresse économique dans un pays qui, quoiqu’en disent les identitaires, n’est pas le faible du fluxmigratoire (qu’il a même parfois le pouvoir de créer par ailleurs, comme en Libye). S’il y a un problème migratoire, et qu’on veut le penser à gauche, il faut comprendre que ce problème est donc aussi et avant tout le problème du migrant. Donc d’élaborer des solutions qui ne renforcent pas son oppression.
Bégaudeau prend aussi le temps de désembrouiller les positions d’une gauche revancharde, qui aime à séparer entre les sexes, entre les couleurs de peau, par esprit de de justice. Mais la justice n’est pas la politique. C’est d’ailleurs encore une fois l’ordre en place qui rend la justice. Cette gauche échoue donc à politiser vraiment et efficacement les problèmes de discriminations (qui sont pourtant bien réels), et produit des concepts qui attisent le feu (« gauche blanche ») plus qu’ils ne s’attaquent son origine. Ce n’est peut-être d’ailleurs pas le but.
Enfin Bégaudeau nous rappelle que la politique ne peut se faire qu’une fois les humeurs refroidies, pas oubliées, surtout pas, colère y compris, mais qu’elles doivent laisser place à la réflexion qui seule est capable de donner les armes pour produire une alternative au système en place. Qui l’a déjà produite par le passé, et qui le refera encore. La politique – la gauche – peut donc se prévaloir – et c’est ce qui termine le livre – d’une espérance qui se traduit en joie. Pas l’espoir qui attend quelque chose, maisl’espérance comme certitude qu’une partie du chemin est déjà accomplie, comme joie de savoir intimement qu’on se suffit à soi-même, et qu’on perdurera, qu’on ne sera jamais vaincus.
Camarade Romain